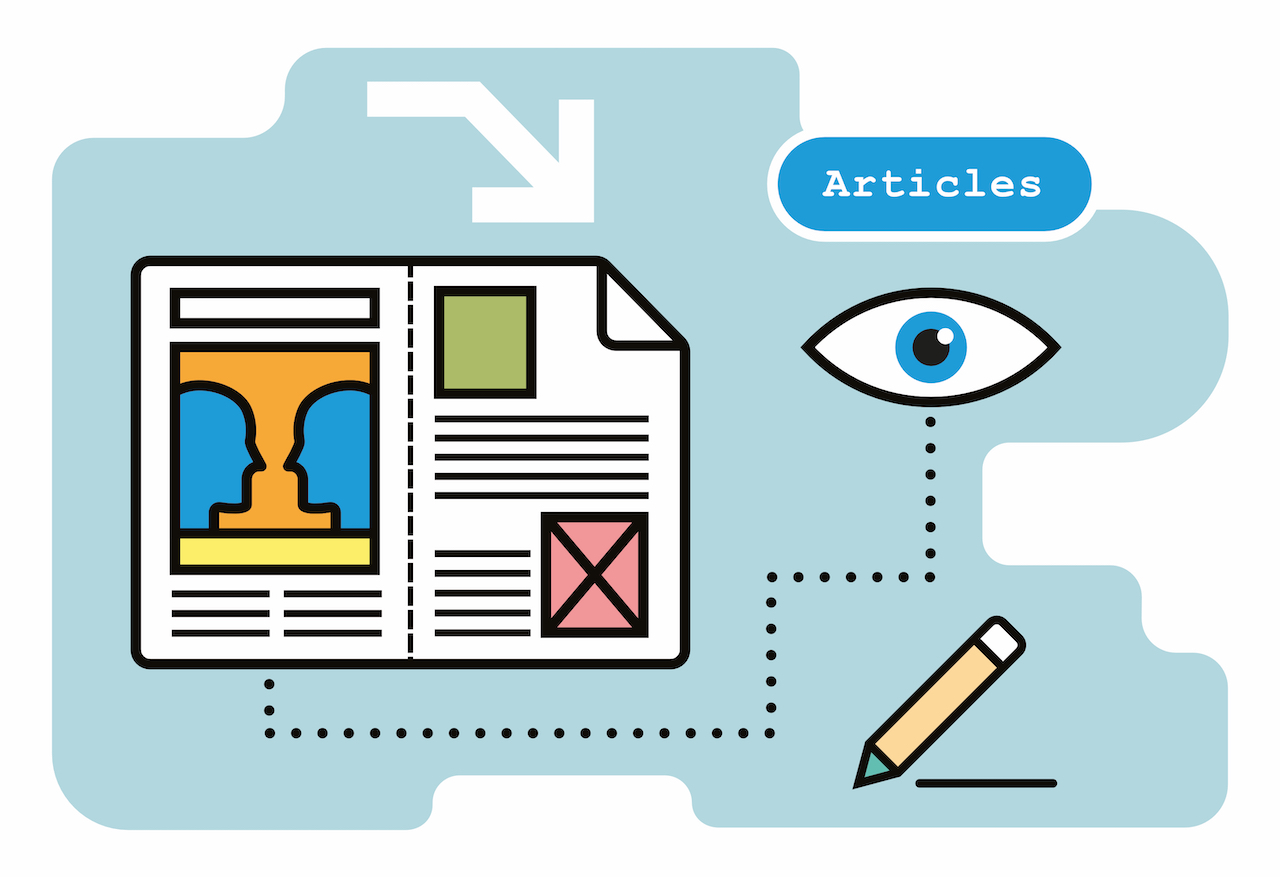Le pouvoir laïque est-il profane ? Classement distinctif et spiritualisation seigneuriale en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge
Fiche du document
2024
- 20.500.13089/134xn
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/1954-3093
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/1623-5770
Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/134xr
Ce document est lié à :
https://doi.org/10.4000/134xr
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Mots-clés
aristocratie tombeaux églises distinction pouvoir seigneurial Haute-Allemagne Zimmern profane/sacré caro/spiritus chevalerie noblesse aristocracy tombs churches distinction seigniorial power Upper Germany Zimmern profane/sacred caro/spiritus chivalry nobility Grabmäler Kirchen Distinktion Herrschaft Aristokratie Oberdeutschland Zimmern profan/sacral caro/spiritus Rittertum AdelSujets proches
Practicing Graves Burial customs Interment Burying-grounds Pratique (musique) Pratique d'une profession Pratique musicale Pratique professionnelle Sépulture Enterrement Ensevelissement PraxisCiter ce document
Joseph Morsel et al., « Le pouvoir laïque est-il profane ? Classement distinctif et spiritualisation seigneuriale en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre | BUCEMA
Partage / Export
Résumé
L’inhumation de défunts dans les églises est une pratique spécifique de la société médiévale, impensable dans la Rome antique et interdite dans la société contemporaine. Il ne s’agit cependant pas seulement d’une variante de la sépulture ad sanctos dans la mesure où cette inhumation est fréquemment manifestée par l’existence d’un tombeau plus ou moins orné, rendant ainsi le défunt visible dans l’église. Initialement réservée aux clercs et aux fondateurs d’établissements ecclésiastiques, cette pratique se diffuse plus largement à partir du xiie siècle. Avoir son tombeau dans une église est généralement interprété soit en termes religieux – piété, peur de la mort, etc. –, soit comme une forme de distinction sociale – soit des arguments génériques qui ne tiennent pas compte du système de représentation médiéval. L’article propose une interprétation différente de cette pratique, en partant d’un terrain empirique spécifique – des seigneurs laïques de Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge – et en prenant au sérieux le schème caro/spiritus – au lieu du binôme courant, quoique daté, profane/sacré –, non seulement comme système discursif, mais aussi, et surtout, comme matrice idéelle effective des pratiques sociales. On peut alors en déduire la corrélation générique établie dans cette société entre la domination sociale – laïque comme ecclésiastique – et l’attribution aux dominants d’un caractère plus spirituel que des dominés, renvoyés au charnel.