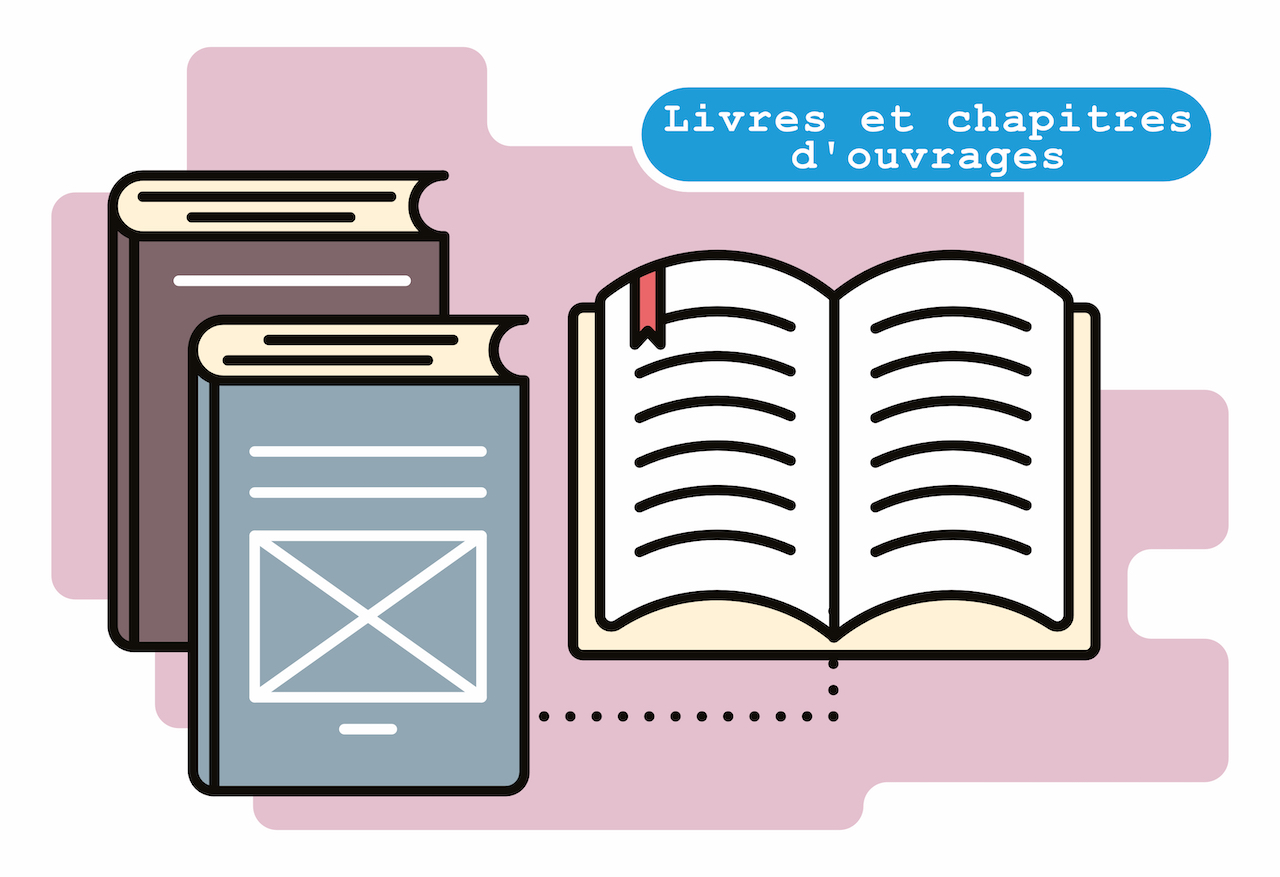Un au-delà de la violence ? Réflexions sur les pratiques de cruauté pendant le génocide des Tutsi rwandais (avril-juin 1994)
Fiche du document
2021
- 20.500.13089/13sem
Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/13sjl
Ce document est lié à :
https://doi.org/10.4000/13sjl
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/979-10-413-0027-3
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-2-7535-8160-9
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citer ce document
Stéphane Audoin-Rouzeau, « Un au-delà de la violence ? Réflexions sur les pratiques de cruauté pendant le génocide des Tutsi rwandais (avril-juin 1994) », Presses universitaires de Rennes
Partage / Export
Résumé
Cette contribution cherche à établir une distinction fondamentale entre violence et cruauté, cette dernière devant se lire comme une violence devenue sa propre fin et destinée à produire un surcroît de douleur chez la victime, douleur aussi bien corporelle que psychique et symbolique. À ce titre, la cruauté est profanatrice, elle porte atteinte au sacré de la victime elle-même, mais aussi à sa famille, à ses proches, à sa communauté. Elle vise plus précisément la filiation tout en provoquant la jouissance des tueurs.Le génocide au Rwanda fut largement lié au retournement meurtrier des voisinages, sans lequel on ne peut imaginer le massacre d’un million de personnes entre avril et juillet 1994. La cruauté fut consubstantielle à cette violence de voisinage. Elle seule put créer la différence manquante, qu’il fallait constituer et approfondir. C’est donc dans l’extrême proximité que pourrait se trouver la réponse à l’énigme du génocide de 1994. Non dans la différence « mineure » pointée en son temps par Freud, mais dans la différence inexistante.