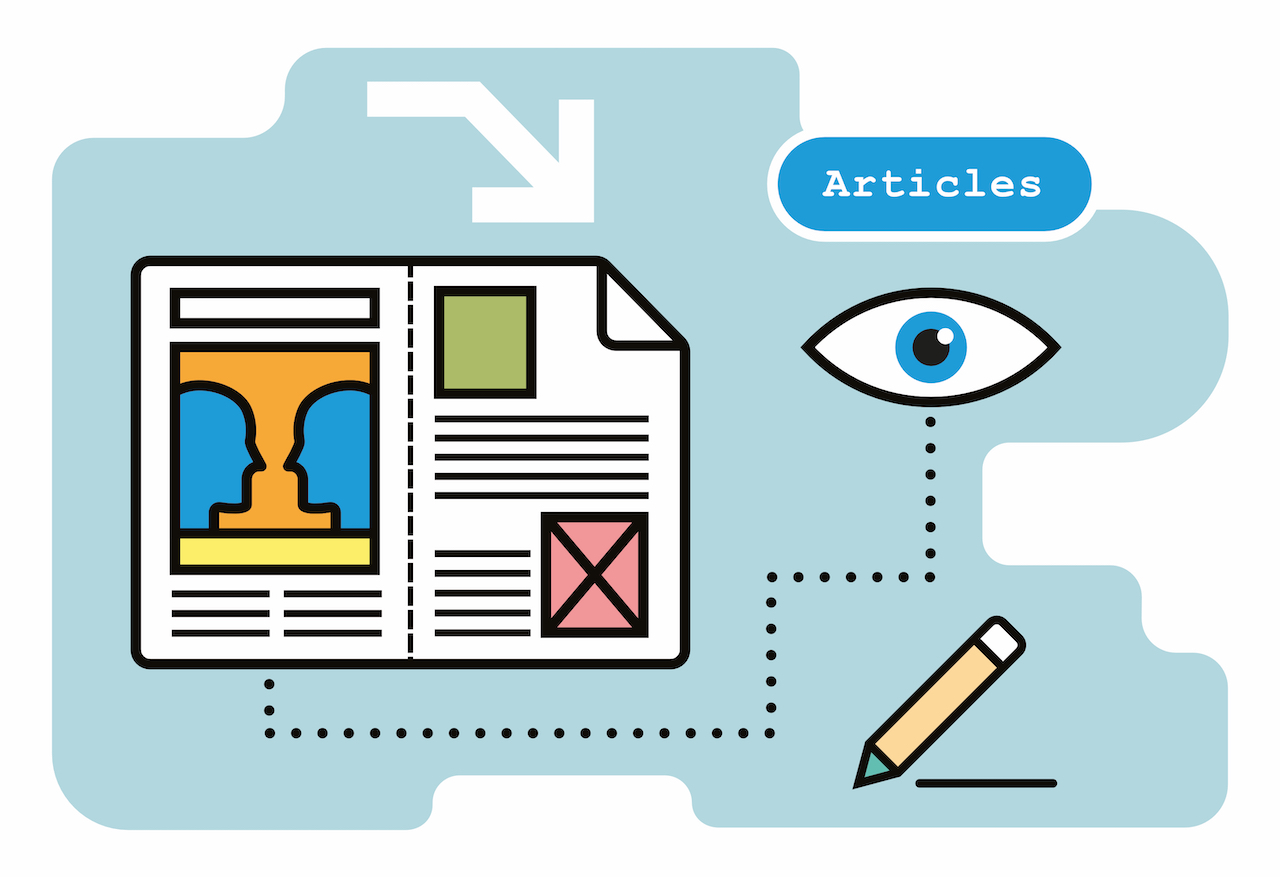Prisonniers de guerre et affirmation de l’État : les Espagnols dans l’Ouest de la France de Corbie à la paix des Pyrénées (1636-1659)
Fiche du document
2018
- 20.500.13089/8ji0
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2108-6443
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/0399-0826
Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/8k4y
Ce document est lié à :
https://doi.org/10.4000/abpo.3792
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Sujets proches
Guerre Sciences de la gestion Gestion, Sciences de la Sciences de gestion Techniques de gestion Direction ManagementCiter ce document
Yann Lagadec, « Prisonniers de guerre et affirmation de l’État : les Espagnols dans l’Ouest de la France de Corbie à la paix des Pyrénées (1636-1659) », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest
Partage / Export
Résumé
La première moitié du xviie siècle est marquée par un changement de statut des prisonniers de guerre en Europe de l’Ouest. Alors que les siècles précédents n’accordaient d’importance qu’à ceux en mesure de payer une rançon, ce sont tous les soldats capturés qui, en un temps où la main-d’oeuvre militaire est de plus en plus recherchée, intéressent les puissances en guerre. L’étude du conflit franco-espagnol (1635-1659) permet de montrer, à partir de l’exemple des villes de l’Ouest de la France, comment l’État royal, tout en cherchant à s’impliquer dans la prise en charge de prisonniers que l’on compte désormais par milliers, se trouve contraint d’en déléguer la gestion quotidienne aux villes. Cette question est alors pour elles lourde d’enjeux, financiers tout d’abord, mais aussi de pouvoirs face à un État de plus en plus présent. La guerre franco-espagnole est d’autant plus importante qu’elle marque le début de la mise en place lente, difficile et fragile des grands principes de gestion des prisonniers jusqu’aux guerres de l’Empire.