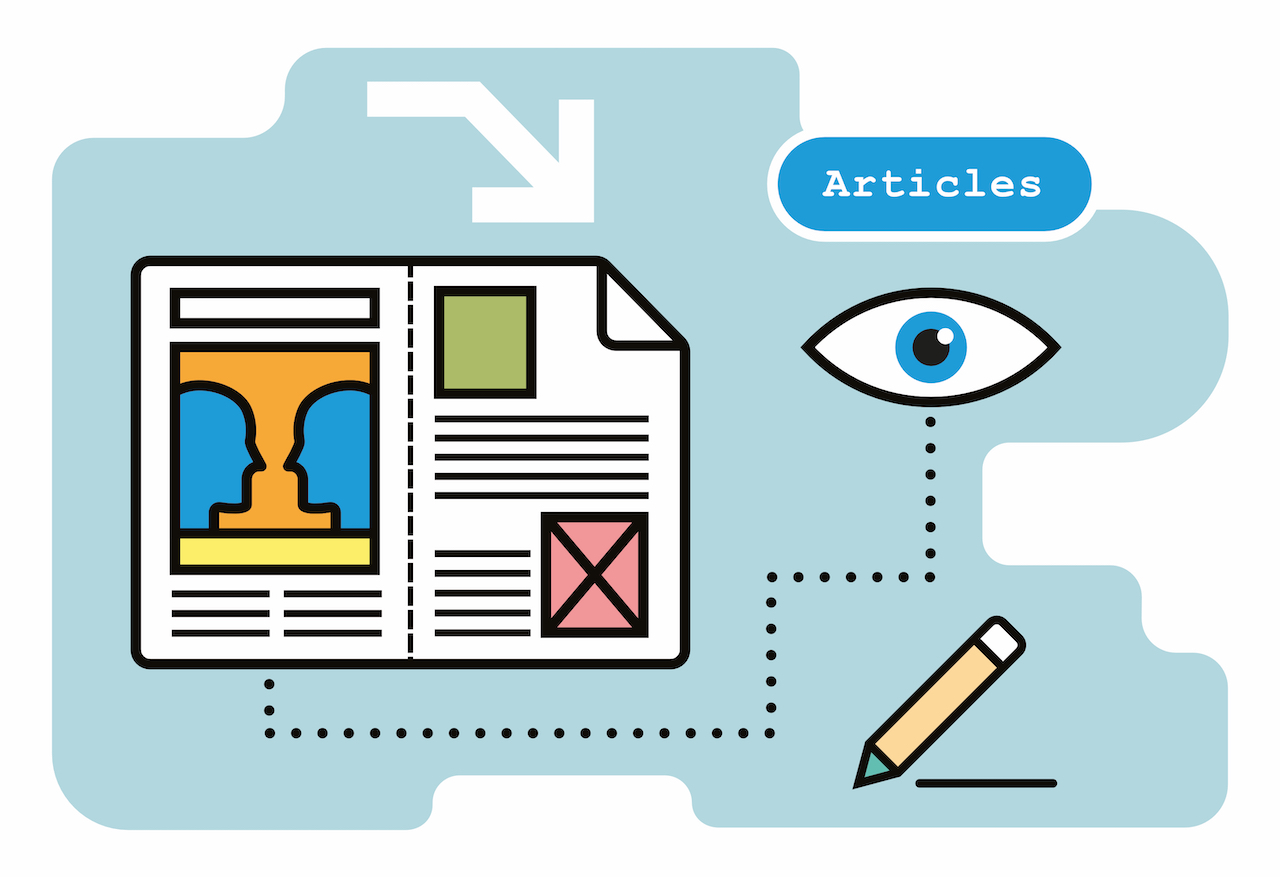Fiche du document
2022
- 20.500.13089/8r9z
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/1760-7914
Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/8rkd
Ce document est lié à :
https://doi.org/10.4000/acrh.26180
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mots-clés
Moyen Âge communication pratiques ordre dominicain règlementation Middle Ages communication practices regulations Dominican order prácticas comunicación orden dominicana Edad Media reglamentosSujets proches
Talking Excarcelación sujeta a condición Puesta en libertad bajo condición Exemplum Frères prêcheurs Jacobins (dominicains) Ordre dominicain Phonation Langage oral Langage articuléCiter ce document
Marie Anne Polo de Beaulieu, « Circulation et contrôle de la parole dans les couvents dominicains (XIIIe-XIVe siècle) », L’Atelier du Centre de recherches historiques
Partage / Export
Résumé
Pour comprendre la genèse et l’application d’un usage idéal dominicain des pratiques langagières, il importe de le replacer dans un contexte paradoxal entre vie active (promouvant une parole exemplaire et efficace) et vie contemplative (valorisant le silence). Héritiers de la tradition monastique de la garde de la langue et acteurs d’un essor sans précédent de la prédication au peuple, les Dominicains doivent devenir les « nouveaux maîtres de la parole », tout en se gardant des péchés de langue, particulièrement étudiés au xiiie siècle. Ils se donnent comme modèles d’éloquence saint Dominique mais aussi les premiers frères de leur Ordre, tout en promulguant une règlementation stricte de la parole à l’intérieur de la communauté qui circule de manière plus verticale qu’horizontale. On verra que des paroles provenant de l’extérieur de la clôture pénètrent dans les couvents, via la mise à l’écrit de sources orales dans les recueils d’exempla et via des échanges de lettres chez certaines moniales dominicaines