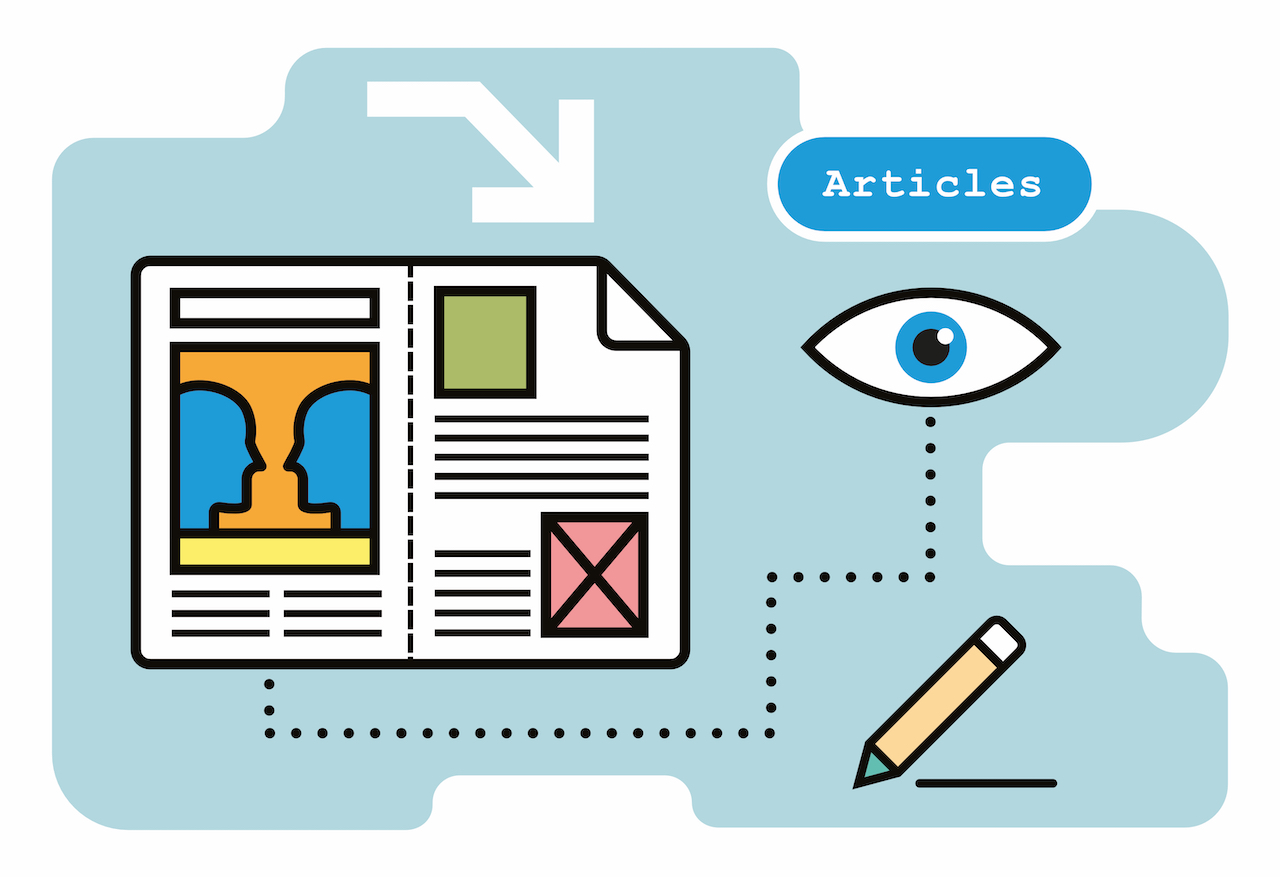Bagnards, « arabes » et porte-clefs en Guyane : Naissance et usages d’un rôle pénal et colonial (1869-1938)
Fiche du document
2019
- 20.500.13089/9nxd
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2109-9405
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/1952-8108
Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/9o48
Ce document est lié à :
https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.4379
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Mots-clés
French Guiana convicts Arab convicts Algerian penitentiary staff porte-clefs Guyane française bagnes forçats arabes Algériens personnel pénitentiaire « porte-clefs arabes »Sujets proches
Imprisoned persons Convicts Correctional institutions--Inmates Prison inmates Incarcerated persons Personas encarceladas Presidiarios Prisioneros Reclusos Forçats Population carcérale Détenus Personnes détenues Bagnards Galériens Personnes incarcérées Porte-clefsCiter ce document
Marine Coquet, « Bagnards, « arabes » et porte-clefs en Guyane : Naissance et usages d’un rôle pénal et colonial (1869-1938) », L’Année du Maghreb
Partage / Export
Résumé
Loin d’être constituée de membres également traités d’une catégorie homogène, l’entité « bagnard » est morcelée selon des catégorisations administratives qui organisent les relations sociales dans et hors les murs des camps. Parmi ces leviers, celui de la « race » est encore peu étudié. Or, selon les années, entre 20 % et 60 % des bagnards transportés en Guyane viennent des colonies du Maghreb et sont catégorisés parmi les « Arabes ».Sur la base des statistiques enregistrées à des fins organisationnelles par l’administration pénitentiaire, il est possible de rendre compte de l’ampleur de la transportation des « Arabes » en Guyane. Croisées aux publications d’époque et à la correspondance de l’administration pénitentiaire avec le ministère des Colonies, ces données chiffrées mettent en perspective les effets de cette typologie pénale sur les relations entre les transportés. Dans les écrits des contemporains, bagnards, journalistes ou médecins, les « Arabes » apparaissent tout particulièrement lorsqu’ils endossent le rôle d’aide-surveillants. « Bagnard », « arabe », et « porte-clefs » : dans une telle configuration punitive, se structure une situation singulière qui semble, a priori, pouvoir ébranler la hiérarchie des « races » communément admise en métropole. C’est à travers cette figure du bagnard « arabe » et porte-clefs que cette contribution se propose de questionner l’organisation sociale des bagnes guyanais.