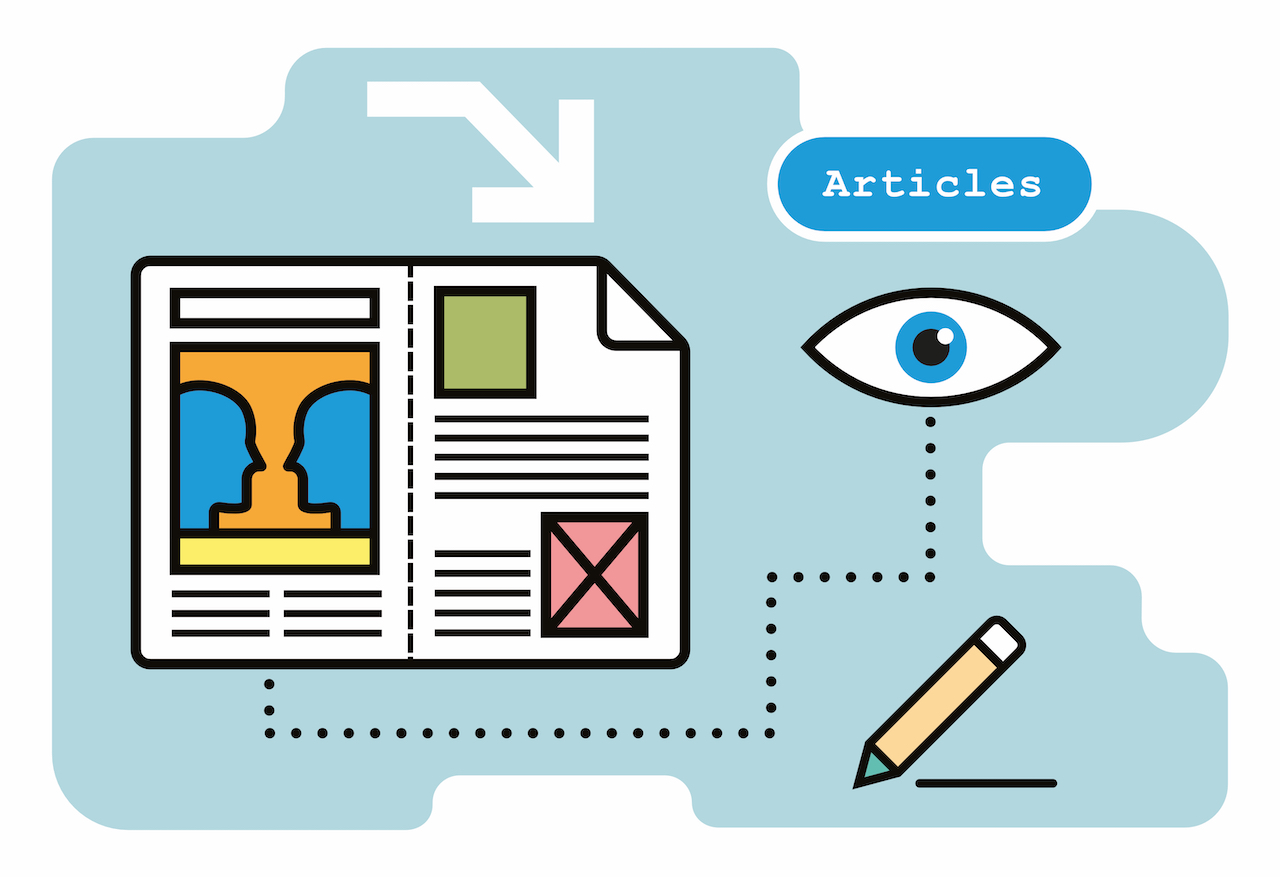Fiche du document
2009
- 20.500.13089/ftld
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2104-3752
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/0755-7809
Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/fttt
Ce document est lié à :
https://doi.org/10.4000/eps.3754
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Mots-clés
migration République Populaire de Chine 20ème-21ème siècles France women international migration 20th-21st centuries outmigration departure People’s Republic of ChinaSujets proches
ImmigrationCiter ce document
Carine Guérassimoff-Pina, « Migrantes, femmes, mères chinoises », Espace populations sociétés
Partage / Export
Résumé
En 2008, selon les chiffres présentés par l’OCDE, les expatriés de la République Populaire de Chine dans le monde seraient 2 070 000. La migration chinoise contribue ainsi à un important phénomène migratoire international marquant le début du XXIe siècle : la féminisation croissante des flux. Présentes aujourd’hui en France, et en Europe, elle participe à la diversification des origines des populations immigrées. Jusqu’à récemment, elles demeuraient peu connues tant dans leurs profils que dans leur processus migratoire. Les données recueillies lors de deux programmes de recherche, nous ont permis de participer à une meilleure appréhension de la migration de ces femmes, de leur place et de leur rôle au sein des flux internationaux de population chinoise et de femmes. Parmi les informations collectées, nous présentons ici celles relatives aux conditions d’élaboration de leur projet migratoire (le départ). Elles comprennent à la fois les causes de la migration (pourquoi sont-elles conduites à construire un projet migratoire ?) ainsi que les modalités de la construction d’un projet migratoire (comment ont-elles été amenées à construire et à initier un projet migratoire ?). Cette étape du projet migratoire des Chinoises présente une double spécificité agissant de manière synchrone : la première est relative à l’appartenance, ou non, à des institutions migratoires, la seconde à leur état de femme.