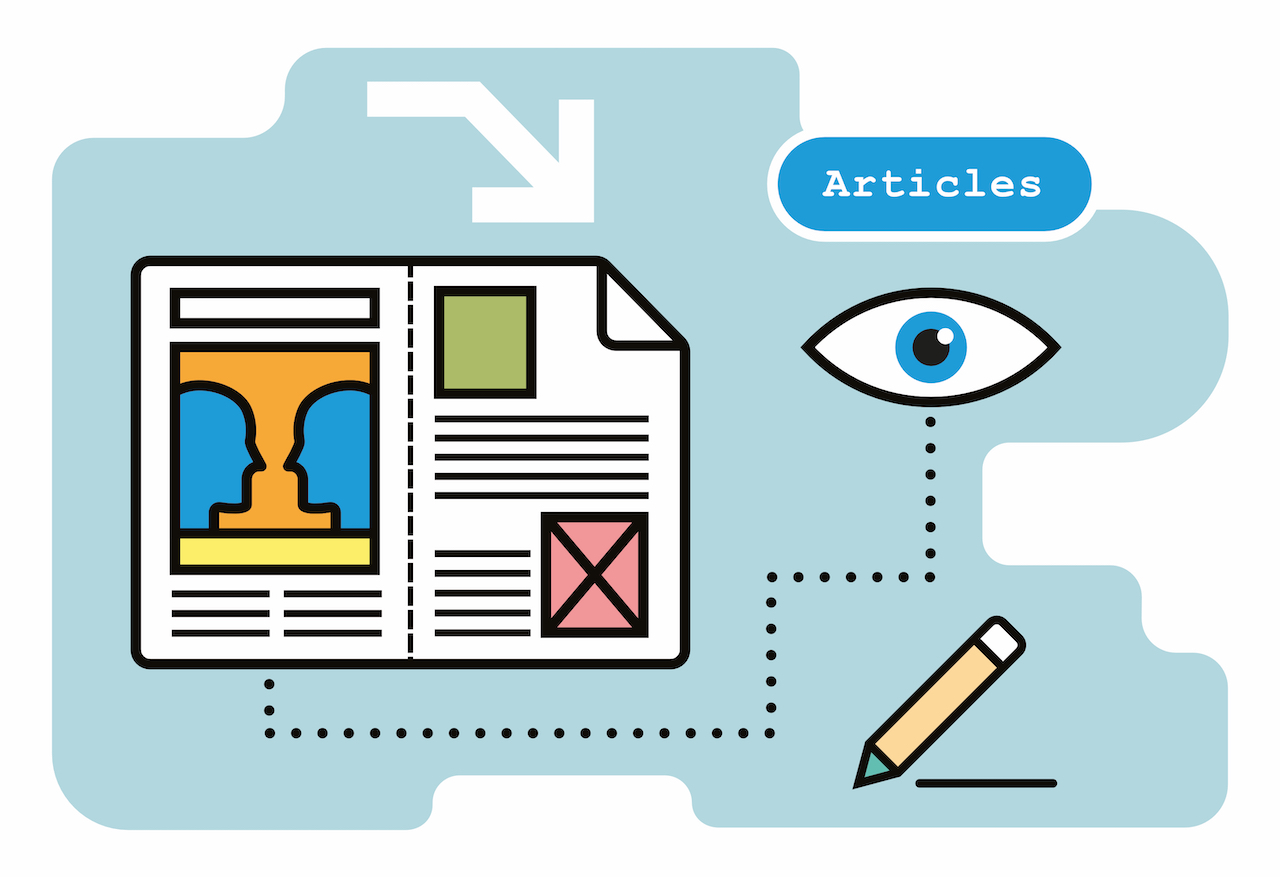Fiche du document
2013
- 20.500.13089/kslm
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/1950-6724
Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/kspf
Ce document est lié à :
https://doi.org/10.4000/socio-logos.2703
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Sujets proches
Parents (père et mère) Ritualité Ritualisme RiteCiter ce document
Rachel Gasparini, « L’entrée en maternelle : le rituel du premier jour », Socio-logos
Partage / Export
Résumé
L’article s’appuie sur une recherche sociologique menée entre 2006 et 2009 dans une école urbaine socialement mixte, concernant vingt-trois enfants suivis à partir de leur entrée en maternelle pendant trois ans (observations en classe et dans l’école, entretiens avec les parents, avec les huit enseignants et les six ATSEM), qui avait pour objectif général de confronter la socialisation familiale et la socialisation scolaire notamment du point de vue de l’autorité. A l’occasion de cette recherche, le moment de l’entrée en maternelle est apparu comme un passage important, symbolique d’enjeux forts de notre société (en termes de réussite scolaire ainsi que de socialisation des enfants) et comportant toutes les caractéristiques d’un rituel contemporain (dimension collective, séparation du reste de la société avec mise à l’écart dans un espace et un temps spécifiques, références communes de croyances sociales qui relèvent de l’éducatif et du psychologique, « moment-clé » vécu sur le mode festif, efficacité institutionnelle pour indiquer à l’enfant le changement de statut et les attendus de comportement liés à ce changement de statut). Face au même rite d’entrée en maternelle, les réactions des parents connaissent des variations, selon leur proximité avec les standards dominants en matière d’éducation, le type de relations entretenues avec l’école et les habitudes familiales. Si plusieurs acteurs interviennent dans ce rite, ils n’occupent cependant pas la même position ni le même point de vue. Les parents peuvent craindre la stigmatisation de leurs pratiques par les professionnels dont l’avis est prépondérant dans l’interprétation du vécu des enfants, vécu qui ne correspond pas toujours à l’idée que s’en font les familles.