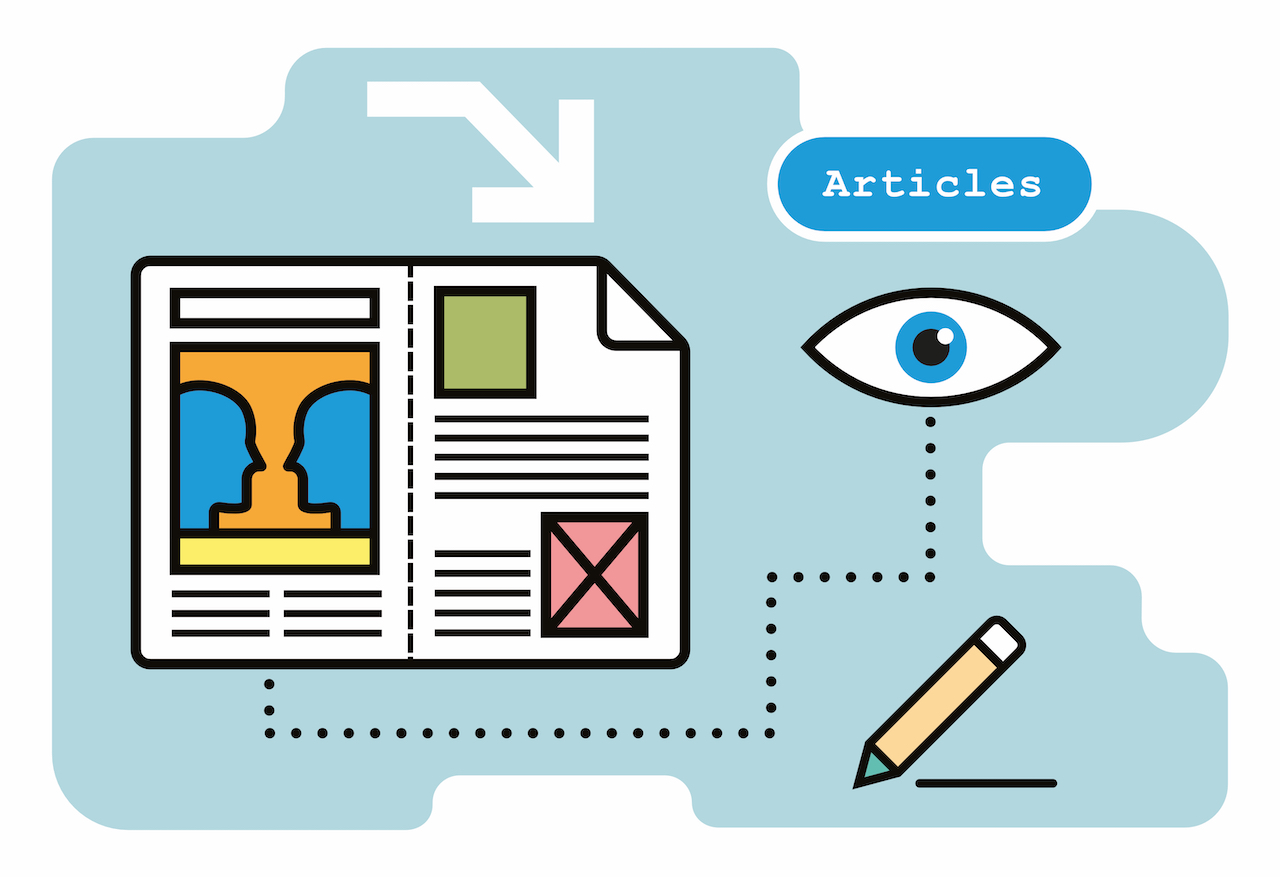Fiche du document
2024
- 20.500.13089/vxu9
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2680-4972
Ce document est lié à :
https://hdl.handle.net/20.500.13089/vxum
Ce document est lié à :
https://doi.org/10.4000/insituarss.2474
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Mots-clés
histoire catastrophe anthropologie disaster studies comparaison history catastrophe disaster anthropology disaster studies comparisonSujets proches
Frontier troubles physical anthropology Anthropologie culturelle Socio-anthropologie Aspect ethnologique Aspect anthropologique Anthropologie sociale Analyse historique Sciences historiques Science historique anthropologie biologique anthropologie physiqueCiter ce document
Sandrine Revet et al., « Les catastrophes, un prisme pour regarder le monde ordinaire », In Situ. Au regard des sciences sociales
Partage / Export
Résumé
L’entretien de Sandrine Revet, anthropologue spécialiste de l’anthropologie des catastrophes « naturelles » et de leur gouvernance, permet de saisir l’histoire et les enjeux épistémologiques de ce domaine de l’anthropologie. En revenant sur son parcours personnel, la chercheuse décrit les inflexions du chantier intellectuel qui prend la catastrophe comme objet de sciences sociales en analysant son déploiement et ses conséquences dans l’espace social et historique spécifique dans lequel la catastrophe advient. Elle évoque d’abord son travail pionnier sur des coulées de boue au Venezuela dans les années 1990 qui a amorcé, avec d’autres études menées au même moment sur d’autres terrains, un tournant anthropologique et critique des disaster studies. Sandrine Revet décrit ensuite les conditions méthodologiques du travail anthropologique sur les catastrophes, ainsi que la place de la comparaison dans le domaine, selon le moment de l’histoire, l’orientation disciplinaire choisie ou encore selon la nature de la catastrophe elle-même. Elle plaide finalement pour une approche ouverte et plurielle, afin de mieux comprendre les spécificités propres de chaque type de catastrophe et de chaque moment de crise, que la comparaison anthropologique permet de saisir, mais ne peut jamais réduire à des modèles prêts à penser. La complémentarité de l’histoire et de l’anthropologie en ce sens est primordiale.