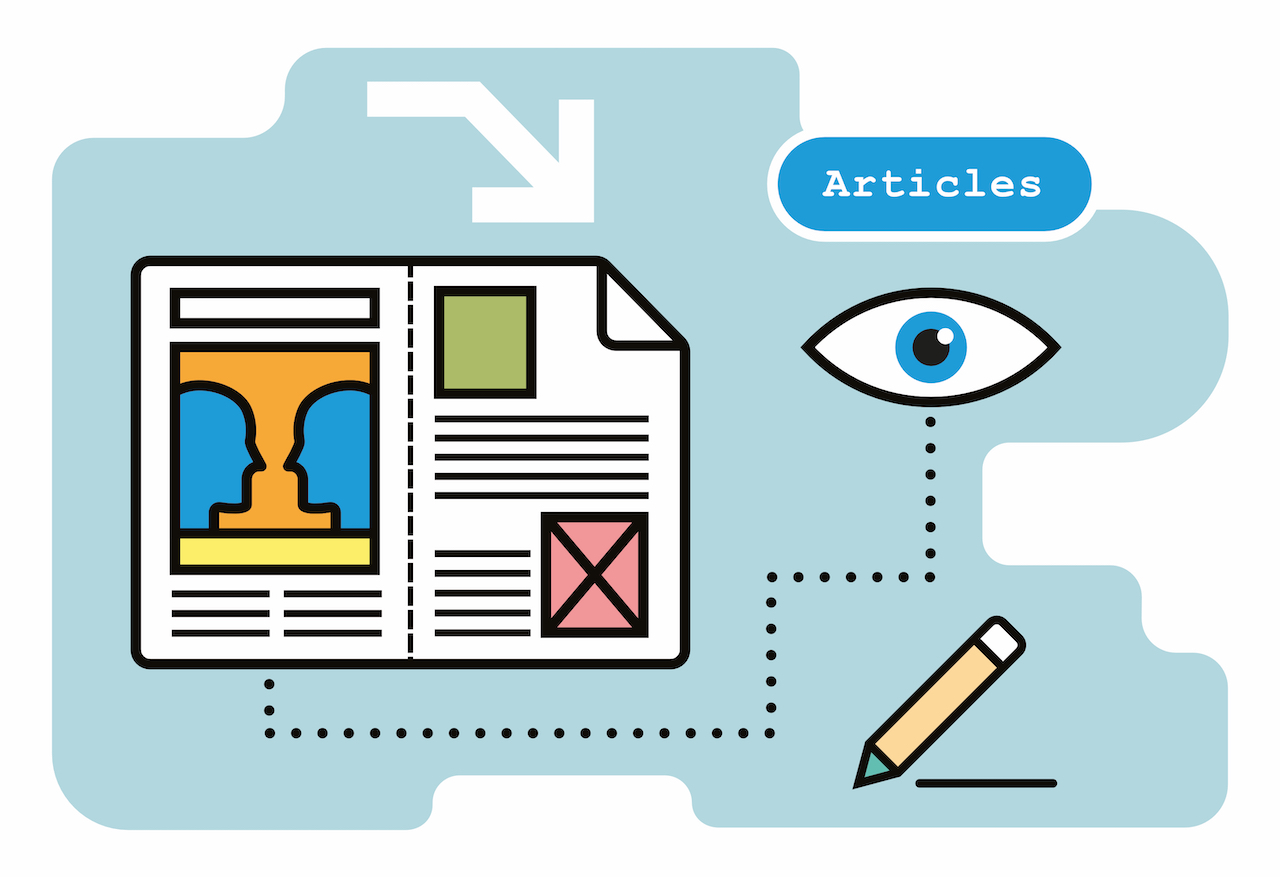Sens du juste et usages du droit du travail : une évolution contrastée entre la France et la Grande-Bretagne au xixe siècle
Fiche du document
1 décembre 2008
- doi: 10.4000/rh19.1148
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/1777-5329
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/1265-1354
info:eu-repo/semantics/openAccess , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Citer ce document
Alain Cottereau, « Sens du juste et usages du droit du travail : une évolution contrastée entre la France et la Grande-Bretagne au xixe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, ID : 10.4000/rh19.1148
Métriques
Partage / Export
Résumé
Les Prud’hommes sont une institution française très mal connue. Leur fonctionnement durant les années 1800-1860 révèle une logique de publicité limitée, la formation d’un droit coutumier, non formulé en principes mais géré au jour le jour, parfois en contradiction avec le système dominant de droit français, une sorte de « common law » du travail. Une comparaison avec la jurisprudence anglaise (Law of Master and Servant) permet de souligner deux logiques opposées : logique de subordination juridique individuelle côté anglais, compensé par une possibilité d’ententes collectives moralement légitimes, hors du droit ; souci d’équité et de réciprocité des marchandages individuels côté français, légalement protégés, gérés par des publics locaux légitimes ; un souci compensé par l’illégalité d’initiatives publiques à plus grande échelle. Mais à partir des années 1860-1880, un changement de doctrine juridique en France s’étend jusqu’aux juridictions des prud’hommes : l’offensive des industriels pousse à ce que l’engagement ouvrier soit considéré comme une soumission et entraîne la disparition d’une expérience originale de « common law » du travail en France.