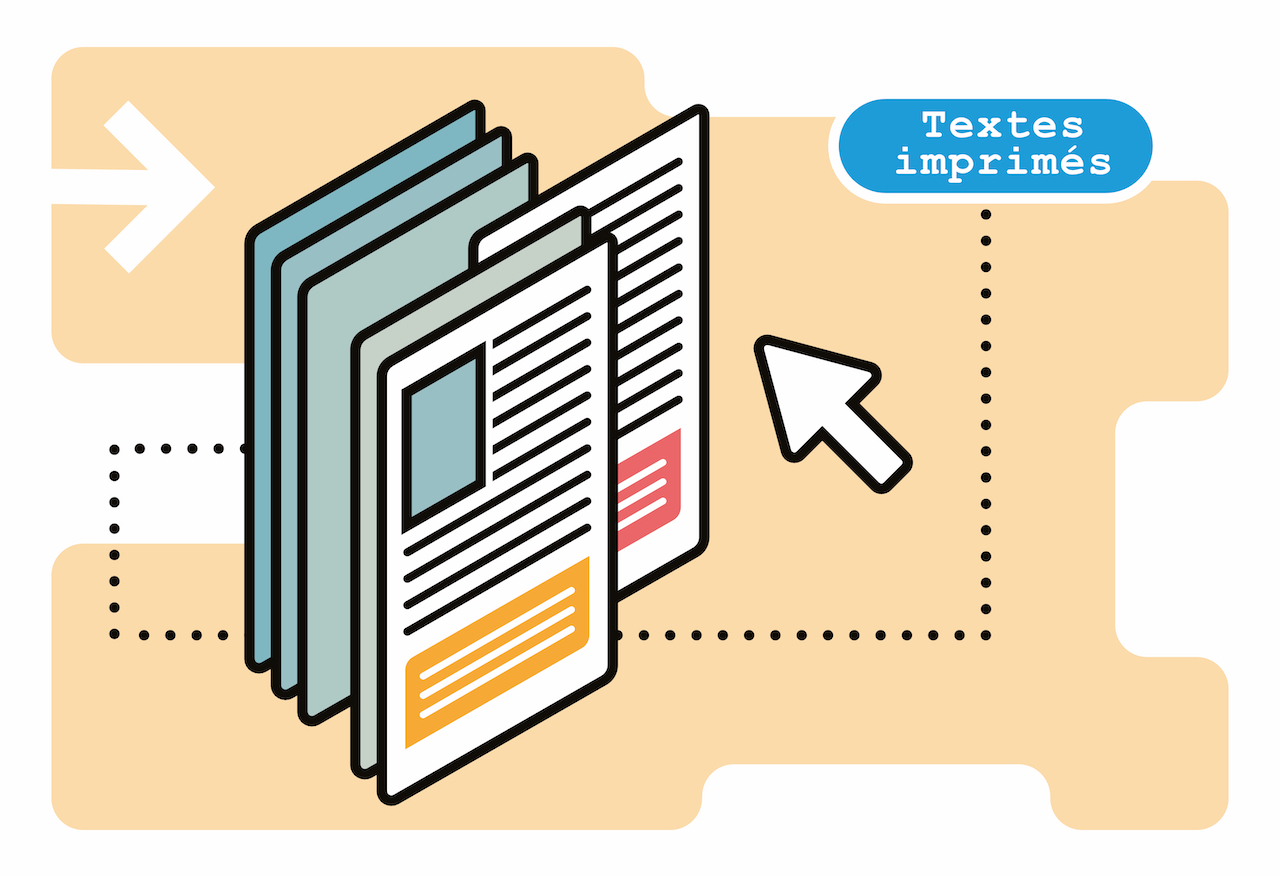Predictors of Participation in Voluntary Vocational Training : An Empirical Study among Canadian Female and Male Managers
Fiche du document
2008
- doi: 10.7202/018576ar
Ce document est lié à :
Relations industrielles ; vol. 63 no. 2 (2008)
Tous droits réservés © Département des relations industrielles de l'Université Laval, 2008
Sujets proches
Manpower development and training Manpower training programs Job training Vocational training Capacitación profesional Formación continuada Formación permanente Formación profesional continua Formation permanente Formation permanente Formation continue Formation professionnelle continueCiter ce document
Julie Cloutier et al., « Predictors of Participation in Voluntary Vocational Training : An Empirical Study among Canadian Female and Male Managers », Relations industrielles / Industrial Relations, ID : 10.7202/018576ar
Métriques
Partage / Export
Résumé
Dans de nombreuses entreprises canadiennes, les travailleurs sont de plus en plus encouragés par leur employeur à se développer par eux-mêmes de façon volontaire, hors des activités de formation obligatoire. Ce type particulier de formation externe réfère à la formation professionnelle volontaire (vocational voluntary training). Il existe très peu d’études portant sur les déterminants de la participation à la formation professionnelle volontaire. Les travaux de Renaud, Morin et Cloutier (2006) figurent parmi les rares études à s’être penchées sur la question. Réalisée au sein d’une organisation du secteur bancaire canadien, leur étude révèle notamment que les femmes cadres présentent une probabilité plus élevée de participer à la formation professionnelle volontaire que leurs homologues masculins. Elle met également en évidence l’effet différencié selon le sexe des facteurs de productivité (ex. : âge, scolarité, nombre d’années de service). En vue d’expliquer la participation supérieure des femmes à ce type de formation, ces mêmes chercheurs ont avancé l’hypothèse selon laquelle les femmes utiliseraient ce type de formation pour compenser le manque de formation obligatoire.À partir des données nationales de l’Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE) (Workplace and Employee Survey – WES) de Statistique Canada, notre étude vise à identifier les déterminants de la participation à la formation professionnelle volontaire de cadres masculins et féminins, respectivement. Trois objectifs spécifiques sont visés : 1) vérifier l’effet différencié des facteurs de capital humain (âge, scolarité, années de service) sur la participation des cadres masculins et féminins grâce à des données nationales, ce qui assure une meilleure généralisation des résultats, 2) vérifier empiriquement si la formation professionnelle volontaire joue un rôle compensatoire pour les femmes, et 3) élargir le modèle d’analyse aux obstacles à la formation professionnelle volontaire en vérifiant empiriquement l’influence qu’exercent les responsabilités familiales.En s’appuyant sur la théorie du capital humain, la théorie de la discrimination systémique et la théorie du conflit travail-famille, six hypothèses de recherche ont été formulées. Les résultats d’une régression logistique indiquent que la scolarité, le nombre d’années de service et le fait d’avoir un conjoint(e) améliorent la probabilité des cadres de participer à la formation professionnelle volontaire. En revanche, l’âge et le fait d’avoir au moins un enfant d’âge préscolaire ont une influence négative sur la participation. De plus, lorsque l’on contrôle l’effet de ces variables, les femmes demeurent plus susceptibles de suivre de la formation professionnelle volontaire que les hommes.Les résultats montrent ainsi que la participation plus importante des femmes à la formation professionnelle volontaire ne s’explique pas entièrement par le fait que les hommes et les femmes possèdent des caractéristiques différentes (facteurs de productivité, formation obligatoire et responsabilités familiales). À ce chapitre, les résultats des régressions logistiques respectivement effectuées pour les hommes et les femmes montrent que la différence de participation observée s’explique largement par l’effet différencié qu’exercent ces caractéristiques. Pour les hommes, la scolarité constitue la seule variable liée significativement à la probabilité de participer à la formation professionnelle volontaire. Pour les femmes, la probabilité de suivre ce type de formation varie en fonction : 1) de l’âge, 2) du nombre d’années de service, 3) du niveau de scolarité, 4) de la participation à la formation obligatoire, 5) du fait d’avoir au moins un enfant de moins de 12 ans et 6) du fait d’avoir un conjoint(e). Ces résultats suggèrent que les hommes et les femmes cadres font une évaluation différente de l’utilité marginale de la formation professionnelle volontaire et qu’ils font face à des contraintes différentes.Pour les femmes, les résultats suggèrent ainsi que les jeunes femmes retarderaient leur investissement dans la formation professionnelle volontaire parce qu’elles anticipent d’interrompre leur carrière pour se consacrer à la maternité. En lien avec la théorie de la discrimination systémique, les résultats suggèrent que les femmes plus âgées participeraient moins à ce type de formation parce qu’elles percevraient moins de possibilités d’avancement de carrière, ou parce qu’elles auraient des aspirations de carrière plus limitées comparativement aux femmes plus jeunes et aux hommes. Toujours en lien avec la théorie de la discrimination systémique, les résultats obtenus en regard des années de service suggèrent que, pour les femmes, la formation professionnelle volontaire s’inscrirait dans une stratégie visant à contrer les effets des pratiques discriminatoires de leur employeur à travers la surqualification. Les résultats obtenus concernant le niveau de scolarité sont également cohérents avec la théorie de la discrimination systémique.Par ailleurs, les résultats suggèrent que les femmes participeraient à la formation professionnelle volontaire notamment pour compenser la formation obligatoire qu’elles n’ont pas reçue de leur employeur. La formation professionnelle volontaire constituerait alors une stratégie parallèle visant à pallier la discrimination fondée sur le sexe en matière de formation. Enfin, les résultats indiquent que les responsabilités familiales constituent un obstacle significatif pour les femmes, ce qui corrobore la théorie du conflit travail-famille. Dans l’ensemble, les variables liées aux responsabilités familiales sont celles qui expliquent le mieux la participation des femmes à la formation professionnelle volontaire.