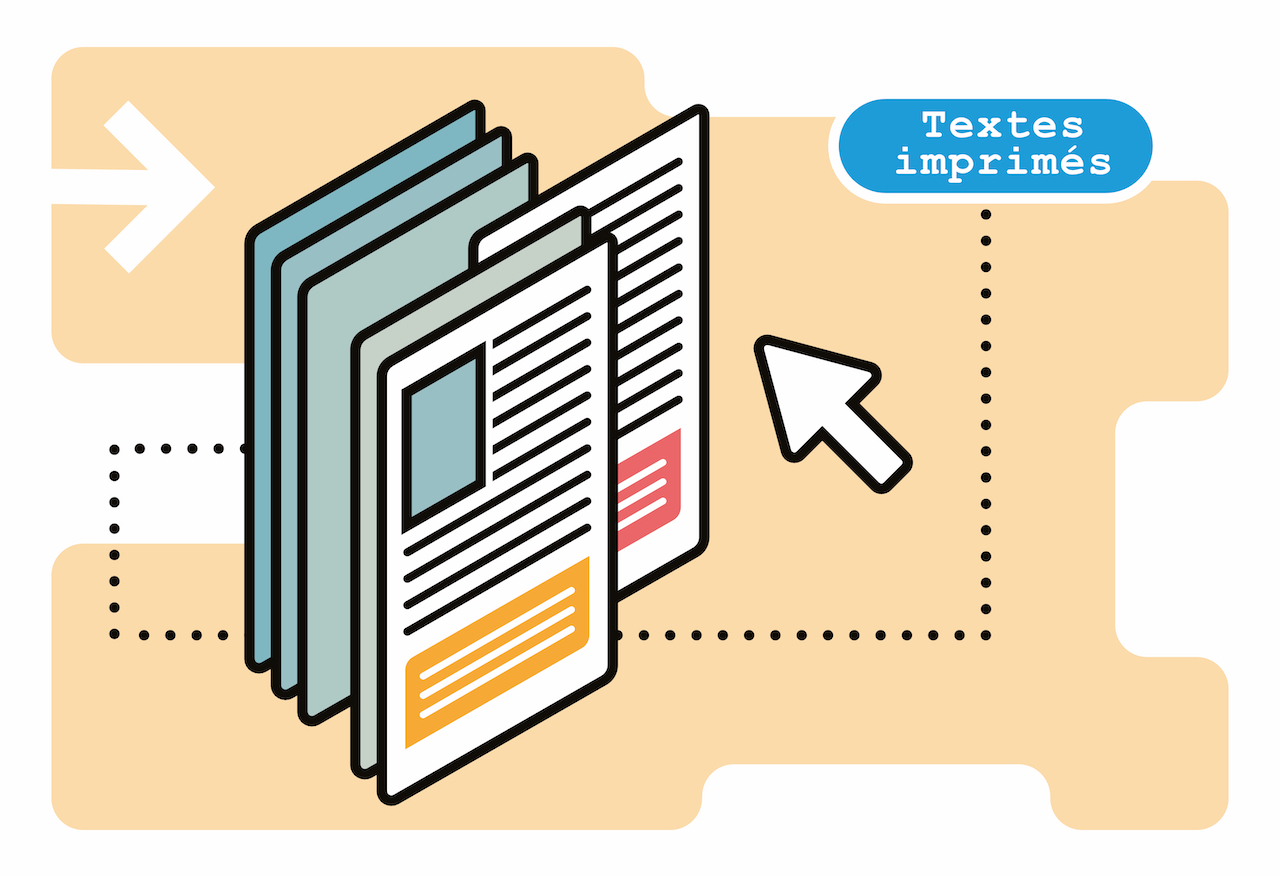Fiche du document
2012
- doi: 10.7202/1009267ar
Ce document est lié à :
Arborescences : Revue d'études françaises ; no. 2 (2012)
Tous droits réservés © Département d'études françaises, Université de Toronto, 2012
Mots-clés
littérature de voyage récit de voyage bilan de recherche décolonisation anthropologie genre réhabilitation poétique histoire altérité texte et image réception philosophie discours colonial théorie postcoloniales histoire connectée travel literature travel narratives research evaluation decolonization anthropology gender studies rehabilitation poetics history alterity text and image reception philosophy colonial discourse postcolonial theories world historySujets proches
Travelogues (Travelers' writings) Writings of travelers Voyages, Carnets de Relations de voyages Voyageurs, Récits de Récits de voyage Journaux de voyages Voyages, Récits de Écrits de voyageurs Carnets de route Impressions de voyages Carnets de voyages Descriptions de voyages Voyages, Relations de Voyage, Récits de Voyage, Littérature de Voyages, Journaux de Littérature de voyage Voyageurs, Écrits deCiter ce document
Grégoire Holtz et al., « Étudier les récits de voyage : Bilan, questionnements, enjeux », Arborescences: Revue d'études françaises, ID : 10.7202/1009267ar
Métriques
Partage / Export
Résumé
Cet article s’intéresse en premier lieu au contexte de renouvellement de la recherche consacrée à la littérature de voyage, à partir de la deuxième moitié des années soixante-dix, qui permet d’en mieux saisir les objectifs intellectuels et les paramètres critiques. Ainsi, les processus de décolonisation créent certains parallèles entre la critique du colonialisme et la « critique » consacrée à la littérature de voyage et expliquent notamment l’intérêt pour les bilans, principalement liés aux travaux sur l’Ancien Régime. L’importance prêtée à ces origines et à ces « premiers contacts » est à son tour l’un des points d’attache réunissant les études sur la littérature de voyage et l’anthropologie. En deuxième lieu est considérée la relation ambivalente qu’entretient la recherche sur la « littérature de voyage » envers la nécessité d’une définition de son objet d’étude, et tout particulièrement envers la notion de « genre ». La définition de l’objet, multiforme, apparaît ainsi secondaire en comparaison à sa réhabilitation ou à son historicisation. En troisième lieu, et en guise de présentation des articles du présent numéro, sont présentés une sélection de discours critiques, de questionnements et d’enjeux ayant investi la littérature des voyages : (1) la poétique du genre, (2) les approches historiques, du new historicism à l’histoire du livre, (3) l’altérité et son étude phénoménologique ou anthropologique, (4) le rapport entre le texte et l’image, (5) la réception des récits de voyage, et notamment la récupération des voyages par la philosophie (6) le discours colonial et les théories postcoloniales, (7) les « histoires connectées ».