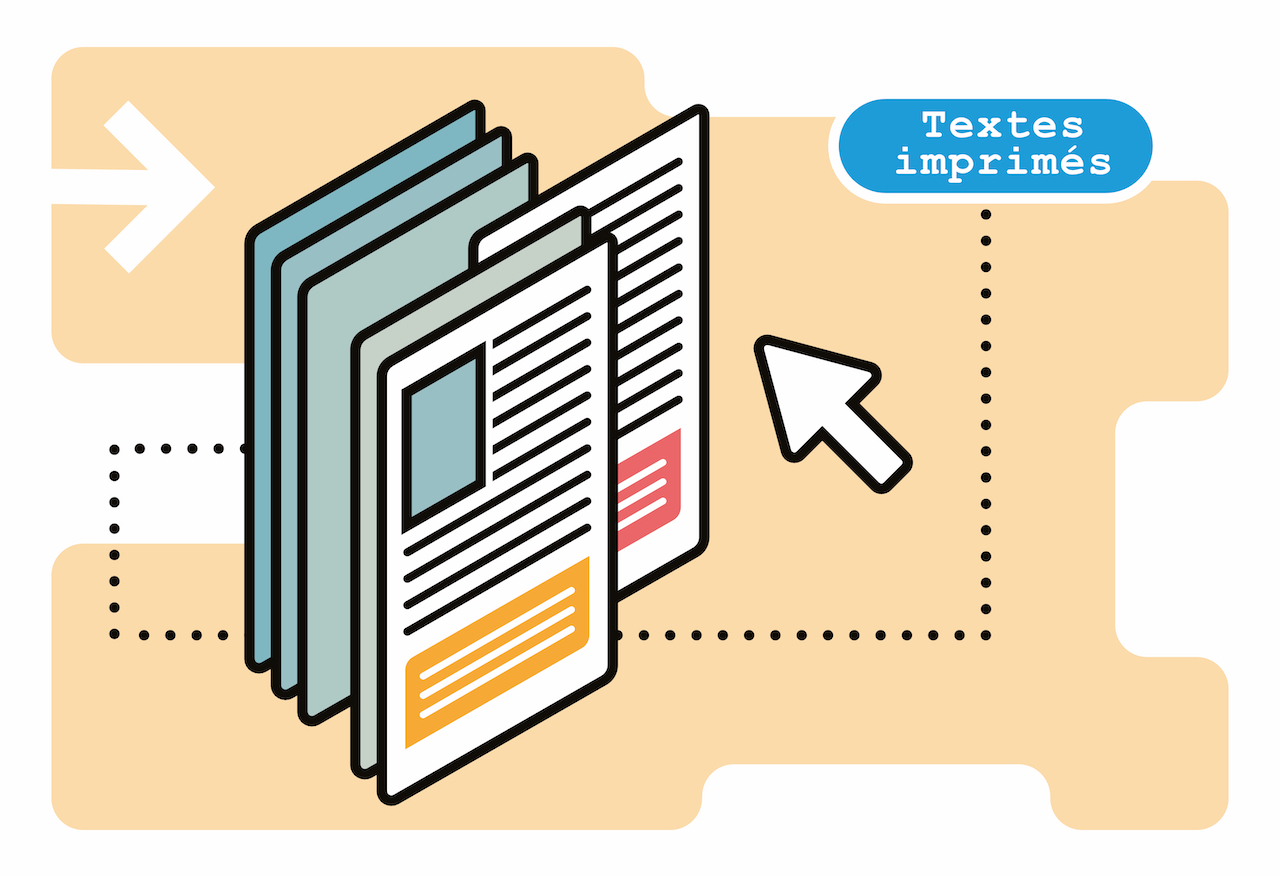Étude d’un recueil d’histoire naturelle coloniale et de plusieurs anecdotes illustrées de Nouvelle-France, ayant appartenu au Duc de Richelieu et issu des activités du Secrétariat de la Marine et des colonies entre 1715 et 1736
Fiche du document
2024
- doi: 10.7202/1112060ar
Ce document est lié à :
Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe ; no. 197 (2024)
Tous droits réservés © Société d'Histoire de la Guadeloupe, 2024
Mots-clés
Anecdotes de notre temps Secrétariat de la Marine Jardin du Roi Académie des Sciences Compagnie des Indes Cabinet de Curiosités Circulation des savoirs Cultures coloniales Colonies françaises Iconographie Premières Nations Comte de Maurepas Antoine-Denis Raudot Duc de Richelieu Le Masson du Parc Pierre Le Chevalier Jussieu XVIIIe siècleSujets proches
Anecdotes, facetiae, satire, etc Anecdotarios Ana Facéties Anecdotique Anecdote Récits anecdotiques CuriositésCiter ce document
Frédéric Blanchard, « Étude d’un recueil d’histoire naturelle coloniale et de plusieurs anecdotes illustrées de Nouvelle-France, ayant appartenu au Duc de Richelieu et issu des activités du Secrétariat de la Marine et des colonies entre 1715 et 1736 », Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, ID : 10.7202/1112060ar
Métriques
Partage / Export
Résumé
Les Anecdotes de notre temps depuis 1715 à 1736, est un ensemble de 52 volumes manuscrits acquis par la Bibliothèque Royale en 1789 au cours de la vente après décès du Duc de Richelieu. La plupart des volumes a été cassée par les archivistes au début du XIXe siècle. Les documents qu’ils contenaient ont été dispersés dans différents fonds thématiques de la Bibliothèque nationale de France. Ces documents associant généralement un texte et une image, qualifiés d’anecdotes, peuvent être identifiés grâce à une estampille assurant leur traçabilité. Un recueil anonyme provenant de ce fonds conserve une quarantaine d’anecdotes, riche de 67 dessins et gravures, de faune et de flore, concernant l’espace colonial français. Une démarche structuraliste intra-inter-trans a permis de reconstituer les micro-histoires liées à chaque anecdote, de confirmer les datations de la plupart des documents iconographiques (1715-1736), de statuer sur le caractère factice du recueil constitué seulement au début du XIXe siècle, et d’identifier des invariants concluant à l’implication d’Antoine-Denis Raudot, intendant des Classes au Secrétariat de la Marine. Celui-ci aurait constitué un corpus « pré-anecdotes » jusqu’à son décès en 1737, dans lequel a puisé le Comte de Maurepas pour élaborer une partie des 52 volumes des Anecdotes de notre temps lors de son exil (1749-1774). Fort de ce constat et du fait que la carrière de Raudot l’a conduit à la co-intendance de la Nouvelle-France (1705-1710), un second corpus de huit anecdotes canadiennes a été identifié puis étudié. Plusieurs images et évènements révèlent d’autres types d’activités du Secrétariat de la Marine, en lien avec les Premières Nations (ambassades, guerre, etc.), une mission sulpicienne, les autorités de Québec et la Royauté. La circulation du corpus « pré-anecdotes » de Raudot vers Maurepas s’explique en partie par divers événements intervenus lors du décès de Raudot en 1737 (héritage, captation).L’iconographie de ces ensembles est d’une valeur tout à fait exceptionnelle par sa diversité, pour l’histoire des sciences et les recherches sur le monde colonial français. Certains dessins complètent les courriers du Secrétariat de la Marine avec lesquels ils furent envoyés. Ils soulignent également l’importance et la diversité des flux de circulation des savoirs et des objets entre les colonies, l’administration de Maurepas, le Jardin du Roi, l’Académie des Sciences, les comptoirs de la Compagnie des Indes, le réseau missionnaire jésuite et la Royauté. Le croisement des sources a permis de lever le voile sur l’identité de plusieurs illustrateurs (Aubriet, Simmoneau, Boutan, Barrère, Jacques, Le Chevalier, etc.).Des liens ont été également identifiés entre les Anecdotes et le Cabinet de curiosités d’Antoine-Denis Raudot, dont au moins un objet provenant de Guadeloupe a été identifié dans le droguier historique dit de Jussieu conservé au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.Si la polysémie qui se dégage des Anecdotes de notre temps déroute en premier lieu, une démarche structuraliste par sous-ensembles thématiques permettant l’identification d’invariants et de corrélations paraît être une méthode particulièrement adaptée. Reste qu’il sera difficile de dissocier les responsabilités du couple Maurepas-Raudot, le ministre et son premier commis, tous deux mobilisés au sein des mêmes administrations durant plusieurs décennies.