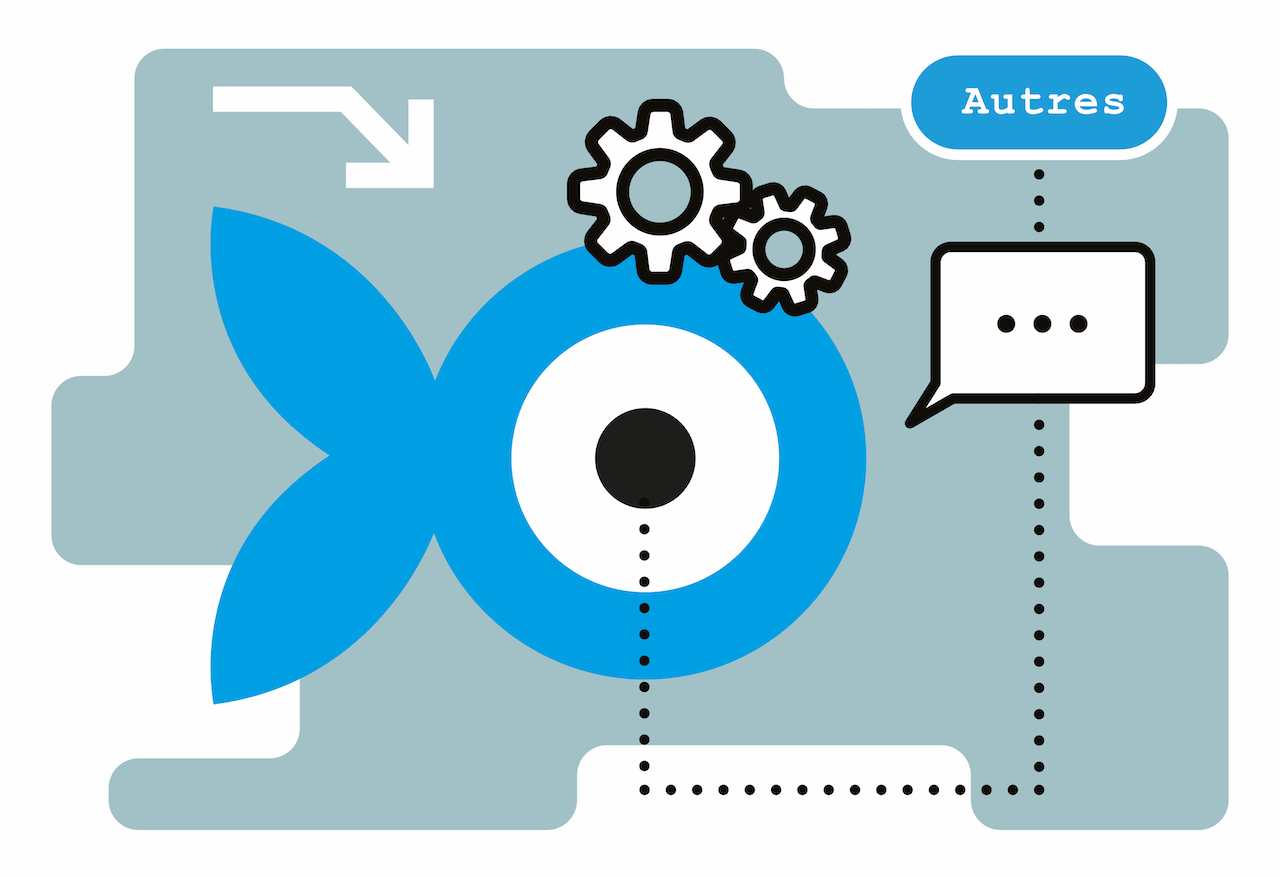Literature before its time : children's picturebooks and literary theory La littérature avant la lettre : l’album pour enfants devant la théorie littéraire
Fiche du document
- ISIDORE Id: 10670/1.05988c...
- hal: hal-04786238
- doi: 10.58282/lht.4319
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.58282/lht.4319
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/
Sujets proches
Reading--Study and teachingCiter ce document
Dominique Perrin et al., « La littérature avant la lettre : l’album pour enfants devant la théorie littéraire », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10.58282/lht.4319
Métriques
Partage / Export
Résumé
Si les études francophones et anglophones sur l’album sont aujourd’hui solidement instituées, c’est ici la première fois qu’une revue de théorie générale se consacre à la littérature texte-image adressée aux (très) jeunes lecteurs, en vue de l’intégrer à une pensée actualisée du littéraire – en veillant à rechercher un équilibre entre effort de théorisation et mise en lumière de corpus représentatifs, transcendant l’analyse d’œuvres singulières et/ou dotées d’une forte légitimité symbolique.Le dossier présenté confronte les outils et questionnements de la théorie littéraire aux spécificités de l’album pour enfants, et réciproquement. Depuis un siècle et demi, les albums placent les enfants en position de lecteurs. Un vaste répertoire poétique, narratif et fictionnel s’offre à leurs pratiques singulières d’appropriation – orales, visuelles et collaboratives. Les inventeurs de l’album ouvrent un champ nouveau, pour la création comme pour la lecture : ils reprennent au livre illustré les jeux sur la mise en page et la matérialité, mais s’en émancipent en inventant un autre rapport texte-image, tout en poursuivant les traditions millénaires de la comptine, du conte et de la fable.Quels fonctionnements pratiques et poétiques caractérisent l’objet nommé « album » en français, « Bilderbuch » en allemand, « picturebook » (souvent en un seul mot aujourd'hui) en anglais, « Álbum ilustrado » et « libro ilustrato » respectivement en espagnol et en italien ? Que peut-on restituer des conditions historiques de son avènement ? Dans quelle mesure peut-on penser la littérature en albums et l’activité de (très) jeunes lecteurs avec les outils de la théorie générale – et quels sont les effets possibles de ce déplacement sur les outils conceptuels et l’épistémologie de la littérature ?Les articles explorent les effets de dévoilement, de friction et de dénaturalisation qu’engendre l’intégration de la littérature en albums au champ théorique général, sous un faisceau d’angles fondamentaux : modalités et fonctions de la lecture (Perrin), genres éditorial et littéraire, rapport texte-image (Fièvre), statuts et fonctions de la narration, du rythme et de la voix (Boulaire), de l’intertextualité (Beauvais), de la métaphore (Tellier), des scénographies énonciatives (Brügger), liens à la tradition narrative orale (Dumont, De Croix et Dufays), rapport à la « postmodernité » et aux apprentissages (Quet). Une place importante est faite à la perspective historique (Fièvre pour une histoire générale de l’objet, Perrin, Boulaire pour une insertion dans l’histoire des cultures orale et écrite occidentales, Quet pour une histoire récente centrée sur les usages scolaires), ainsi qu’aux données actuelles de la recherche en sciences humaines et du développement (Boulaire, Beauvais). La description d’un sous-genre emblématique du champ et de sa solidarité avec la tradition orale est associée à l’analyse de données de réception (Dumont, De Croix, Dufays sur le « conte en randonnée »). Enfin, les deux derniers textes rendent compte de réflexions menées directement du point de vue de la création (Gavarry, Sendak). Le dossier associé d’Acta fabula rend compte des grandes directions d’une recherche à caractère internationalisé.