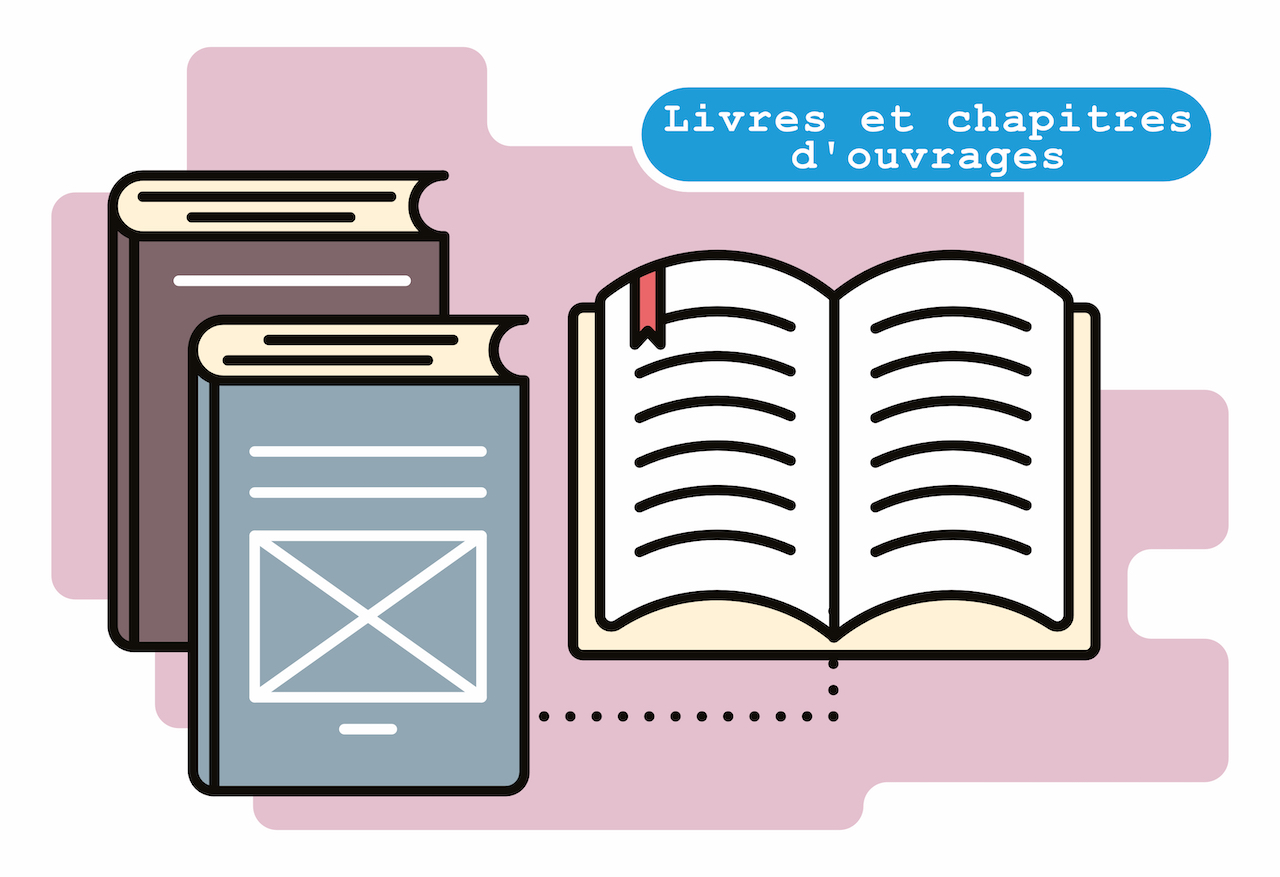Rhythms and revolution: off-beats, syncopations, repeats Rythmes et révolution : contretemps, syncopes, reprises
Fiche du document
2024
- ISIDORE Id: 10670/1.1bd47c...
- hal: hal-04858608
http://creativecommons.org/licenses/by/ , info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Mots-clés
French revolution untimely rhythm contretemps syncope riot civil institutions long time révolution française intempestif rythme contretemps syncope émeute institutions civiles temps longSujets proches
Hours (Time) Duración Horas (Tiempo) Rythme (esthétique) Rythme (linguistique) Rythmique Rythme (poétique)Citer ce document
Sophie Wahnich, « Rythmes et révolution : contretemps, syncopes, reprises », HAL SHS (Sciences de l’Homme et de la Société), ID : 10670/1.1bd47c...
Métriques
Partage / Export
Résumé
L’événement révolutionnaire est supposé échapper à la rythmique ordinaire car l’intempestif vient rompre le rythme et casser le temps. Dans les mots de R. Koselleck, le champ d’expérience mais aussi l’horizon d’attente deviennent caduques . Ils ont été troués, débordés par le neuf qui advient. Mais pour autant, faut-il renoncer à voir autre chose de plus lent, plus souterrain ou seulement moins immédiatement visible dans le temps révolutionnaire ? J’aimerais ici explorer l’hypothèse d’un rythme en contretemps et syncopé qui permettrait de saisir ce qui se trame sur une temporalité autre avant que ne surgisse le temps de l’émeute et après le temps de l’émeute. J'aimerais ainsi explorer ce qui sépare en période révolutionnaire une politique de l'émeute, une politique de la terreur et une politique des institutions civiles en termes de rythme.L'hypothèse est la suivante. L'émeute révolutionnaire surgit mais ses acteurs doivent avoir longuement muri un texte caché une formation discursive idéologique qui d'un seul coup apparaît comme norme. Un mouvement populaire associe ainsi un rythme vif et un rythme très lent. La réussite de l'émeute témoigne d'une adéquation entre formation idéologique et formation sociale, mais elle ne devient révolution que si une formation politique a maturé, sur le temps long lui aussi, et réussit à incarner des attentes multiples et syncopées.