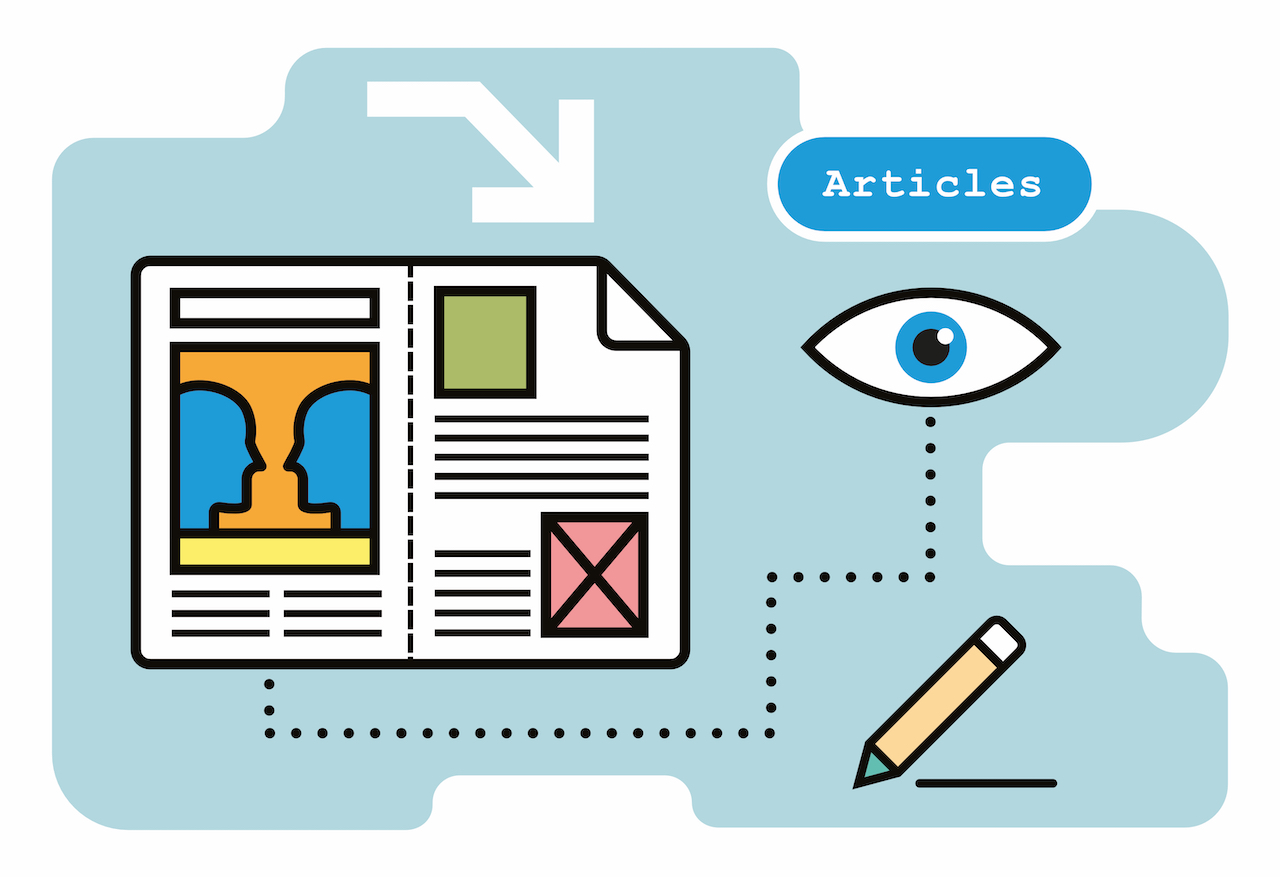Fiche du document
2024
- ISIDORE Id: 10670/1.31ef1d...
- halshs: halshs-04874185
- doi: 10.4000/12w7u
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.4000/12w7u
Citer ce document
Cyril Isnart et al., « Le revivaliste et ses sources. Collectages et destins de la musique traditionnelle », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10.4000/12w7u
Métriques
Partage / Export
Résumé
L’étrange partage de l’ethnographie par des professionnels ethnologues de la France et des revivalistes lancés dans l’aventure du collectage musical n’est pas réductible à une opposition entre l’ethnographie des cultures paysannes légitimée par les institutions et un activisme artistique basé sur les répertoires jugés disqualifiés par ses promoteurs. En postulant au contraire que le revivalisme a construit une, ou plutôt des ethnographies, plurielles et expérimentales, collaboratives et autonomes, collectives et individuelles, apparaissent alors les chemins singuliers que des musiciens, épris d’autres esthétiques et portés aussi par des passions politiques, ont empruntés sur le territoire français. Produits mouvants et instables de leurs liens à des territoires qu’ils découvraient ouverts, à des savoirs musicaux qu’ils souhaitaient conquérir et à des institutions qu’ils ont domestiquées, inventés ou refusées, les collectages constituent bien une source, autant ethnographique que musicale, sur laquelle les tenants de la « tradition » ont bâti leurs destins. À travers l’évocation de quatre figures contrastées du paysage français, Michel Valière, Olivier Durif, Jérôme Casalonga et Manu Théron, il devient peut-être plus facile de penser, à l’image de l’ethnographie de la France pensée par Daniel Fabre, la pluralité native des revivalistes et de leurs sources.