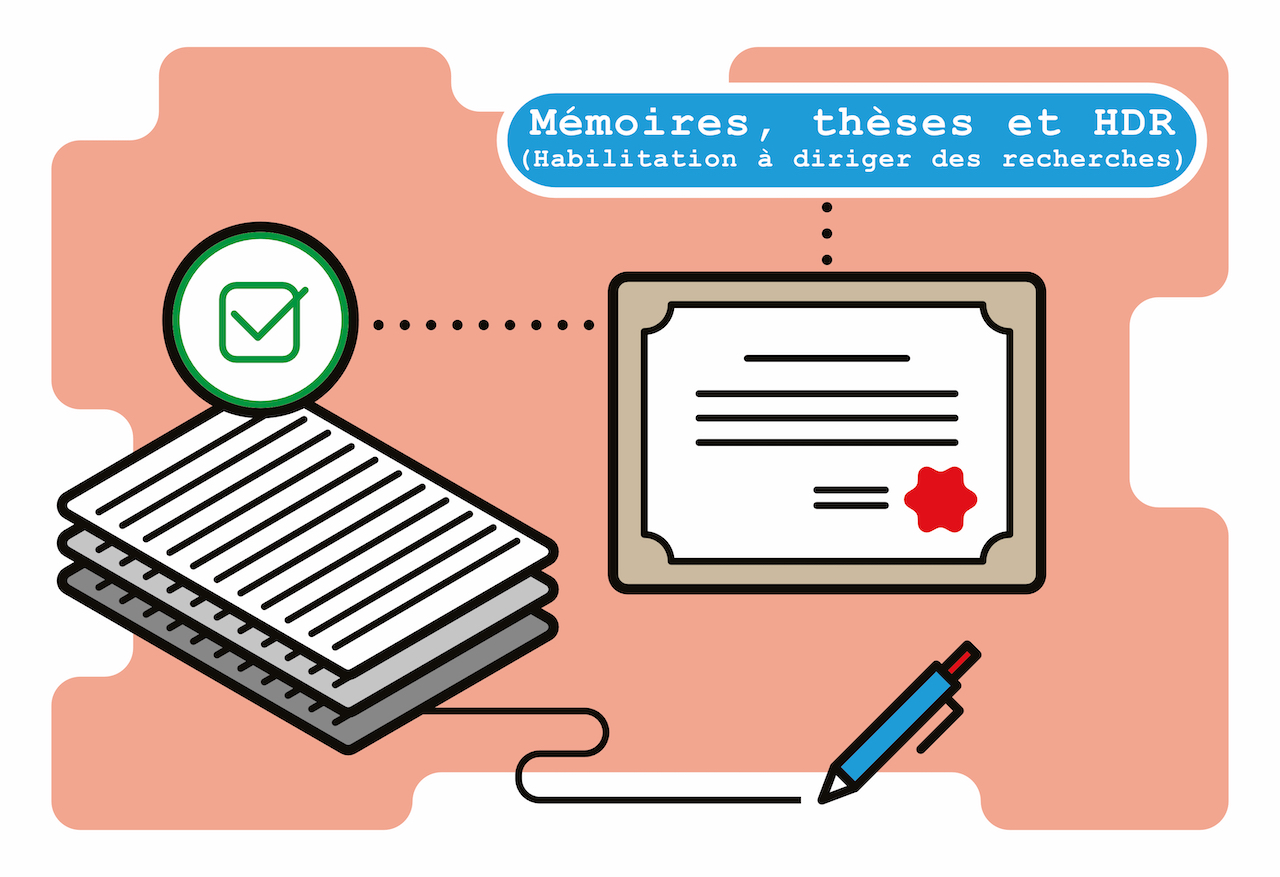Personal ornaments analysis to explore the cultural and social diversity in Europe during the Gravettian Analyse des objets de parure pour explorer la diversité culturelle et sociale au cours du Gravettien en Europe
Fiche du document
19 novembre 2024
- ISIDORE Id: 10670/1.326264...
- NNT: 2024BORD0277
- tel: tel-04826359
info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Mots-clés
Upper Palaeolithic Aurignacian Bead Network Mantel tests Neighbour-joining Grave goods Burial Social complexity Paléolithique supérieur Aurignacien Perle Réseau Tests de Mantel Neighbour-joining Objets funéraires Sépulture Complexité socialeSujets proches
Council of Europe countriesCiter ce document
Jack Baker, « Analyse des objets de parure pour explorer la diversité culturelle et sociale au cours du Gravettien en Europe », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.326264...
Métriques
Partage / Export
Résumé
Le Gravettien (34-24 ka) est largement considéré comme le dernier technocomplexe paneuropéen avant la fragmentation régionale de la population à la suite du dernier maxima glaciaire. Il a été démontré que les ornements personnels sont de puissants indicateurs du statut social et de l'appartenance culturelle. Jusqu'à présent, les ornements personnels omniprésents dans les sites d'occupation et de sépulture caractérisant le Gravettien n'ont pas encore fait l'objet d'une étude approfondie. L'objectif principal de la thèse était de documenter la variabilité des associations de types de perles et d'identifier les mécanismes à l'origine de cette diversité à l'échelle régionale et européenne au cours du Gravettien. La réalisation de cet objectif a ouvert la voie au second objectif : l'étude de la géographie culturelle des communautés gravettiennes. Dans un premier temps, nous proposons une analyse approfondie des nombreuses parures provenant d'un site funéraire clé du Gravettien, Cro-Magnon (Dordogne, France). Ensuite, nous avons créé une base de données géoréférencée représentative des parures du Gravettien, comprenant 164 types provenant de plus de 130 sites à travers l'Europe, et nous l'avons analysée à l'aide de méthodes statistiques multivariées et spatiales, telles que l'analyse des coordonnées principales (PCoA), le Neighbour-joining, le Neighbour-net, la sériation et les corrélations et corrélogrammes de Mantel. Nous avons ensuite comparé et mis en contraste les parures du Gravettien avec celles de l'Aurignacien précédent en utilisant des analyses similaires afin d'étudier s'il existait une continuité entre ces deux technocomplexes. L'analyse des parures trouvées à Cro-Magnon a révélé l'existence de vastes réseaux d'échange à travers le continent. Malgré des similitudes avec les parures d'autres groupes voisins de Dordogne, les parures de Cro-Magnon présentent un caractère distinctif, c'est-à-dire peu, plutôt que beaucoup, de pendentifs en ivoire décorés et beaucoup, plutôt que peu, d'ornements en coquillages, ce qui souligne le désir de ce peuple d'affirmer son identité unique dans un contexte symbolique plus large. Le recalibrage de la seule date radiocarbone disponible pour ce site suggère qu'une campagne de datation plus étendue est nécessaire pour attribuer chronologiquement ce site emblématique avec précision. L'analyse de la base de données du Gravettien européenne révèle que ce technocomplexe était divisé en neuf groupes qui portaient des associations de types de perles différentes, organisées d'ouest en est. Alors que les groupes gravettiens de l'est de l'Europe 10 portaient des parures principalement en ivoire, en pierre et en dents de mammifères carnivores, les groupes de l'ouest avaient tendance à porter des perles fabriquées à partir de coquillages marins et de dents de mammifères herbivores. Il a été démontré que les différences observées dans les associations de types de perles n'étaient pas uniquement dues à l'isolement par la distance. Nous en avons conclu qu'un sentiment d'appartenance culturelle dictait les types de parures portés par les différents groupes de Gravettiens. Les sites d'inhumation et d'occupation se caractérisent par des schémas distincts d'associations de parures. La différence observée entre les groupes d'inhumation était plus importante que la différence entre les groupes d'occupation. La comparaison des parures du Gravettien et de l'Aurignacien a révélé des similitudes frappantes entre les deux technocomplexes en termes de choix de parures. Le Gravettien se caractérise par des régions d'associations de parures similaires, dont la surface est plus de dix fois supérieure à celle de l'Aurignacien et qui sont plus interconnectées que ces dernières. Les types de parures entièrement sculptés dans des matériaux osseux et lithiques marquent mieux le fossé culturel entre ces deux technocomplexes que ceux produits à partir de formes naturelles minimalement modifiées.