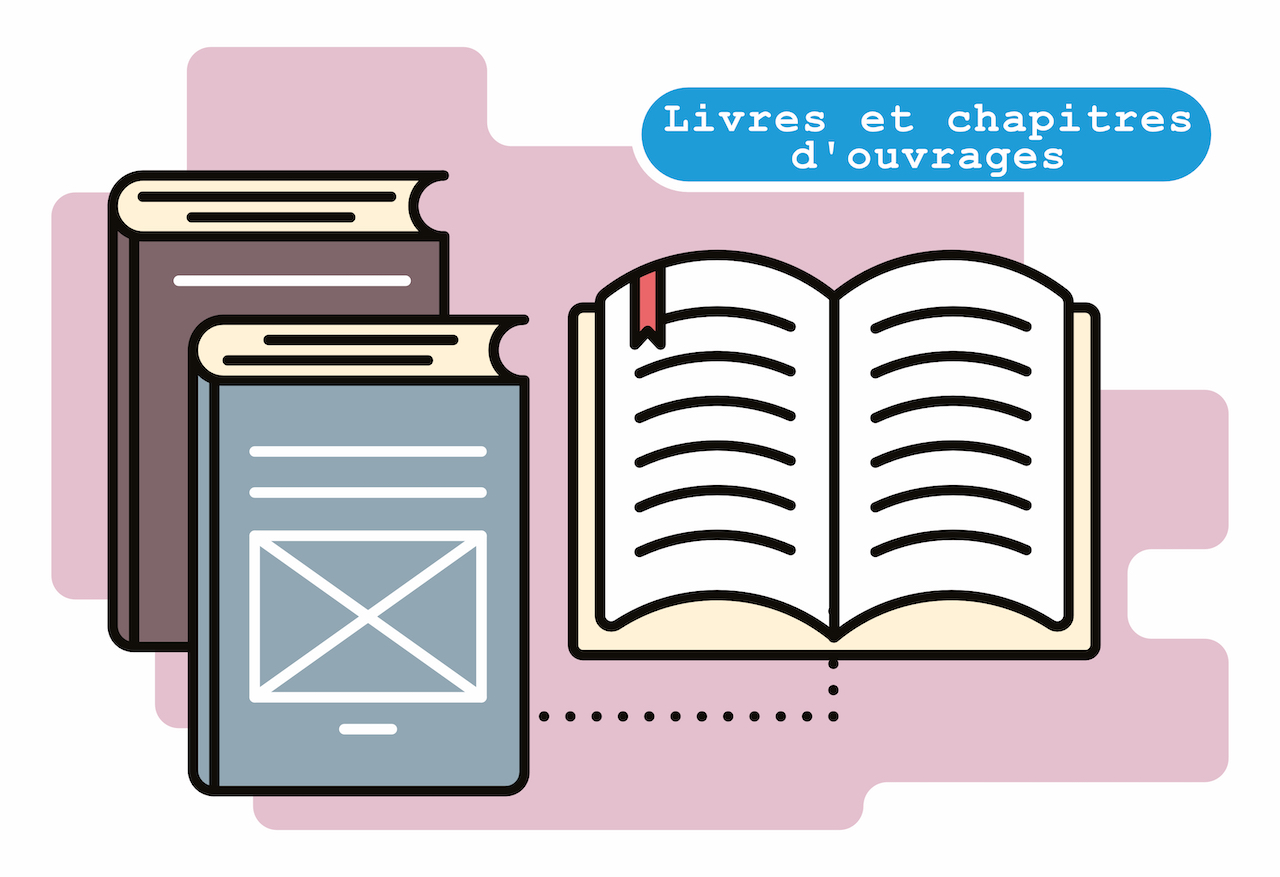Fiche du document
2011
- ISIDORE Id: 10670/1.357933...
- isbn: 978-2-271-07104-0
- hal: hal-01069747
- doi: 10.4000/books.editionscnrs.16650
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.4000/books.editionscnrs.16650
Sujets proches
Natural science Sciences Science of science Signifiant Sémantique Information de presse Nouvelles (journalisme) Informations Interprétations Sémasiologie Sémantique (linguistique) Sciences pures Sciences exactes Sciences fondamentalesCiter ce document
Nathalie Baudouin et al., « Les interactions homme-machine : la trace en perspective », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10.4000/books.editionscnrs.16650
Métriques
Partage / Export
Résumé
Nous concevons ici la trace, à l'instar du poème d'Antonio Machado, comme un construit chemin faisant, c'est-à-dire dans une tradition ignorante tant du point de vue des sciences de l'information et de la communication3 que de l'informatique et du traitement automatique des langues. Il ne sera pas ici question de la découverte d'un objet inscrit dans une matérialité, ni même d'une trace mnésique, témoin d'une " inscription perceptive " dans le psychisme, mais de ce que le sujet inscrit, volontairement ou non, lors d'une navigation intertextuelle dans un corpus de documents numériques en même temps qu'il en reste durablement " impressionné ". Cette " trace " en devenir n'est constituée en tant que trace que lorsqu'elle est interprétée. Elle a pour fonction de faciliter l'interprétation d'un utilisateur en " lui permettant de se revoir agir ". Ce type de trace pourrait s'assimiler à ce que François Rastier nomme un faisceau d'isotopies (un fond sémantique comme principe de cohérence textuel) qui repose sur un principe différentiel, essentiel depuis Saussure, et à partir duquel se construit notre perception sémantique hautement culturalisée. Le travail d'interprétation se constituant dans " la polarité entre familiarité et étrangeté " (GADAMER, 1976), le texte peut être appréhendé comme un cours d'action qui se régénère en s'interprétant (RASTIER, 2006).