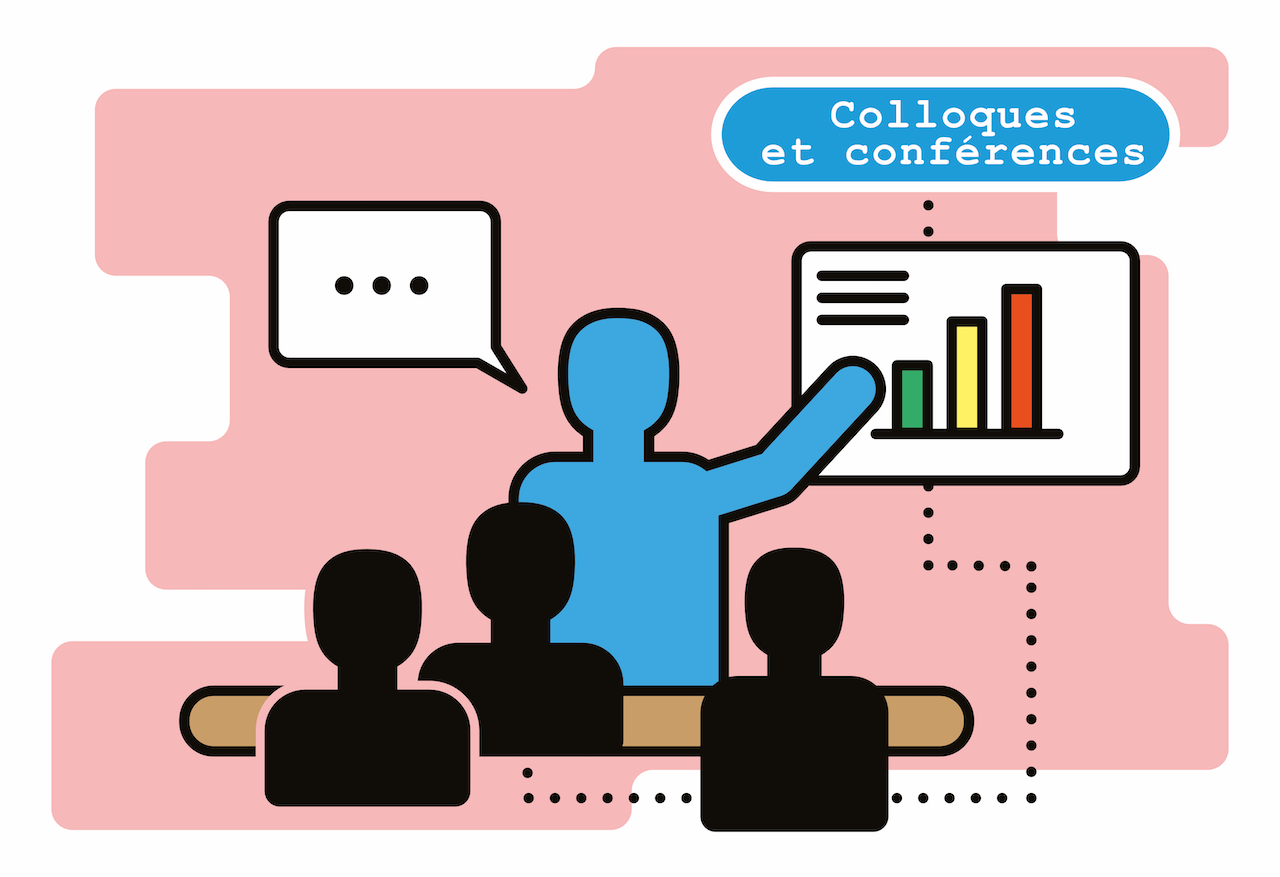Radiocarbon Dating of Iron: Methodology and Applications La datation du fer par le radiocarbone : méthodologie et applications
Fiche du document
3 décembre 2024
- ISIDORE Id: 10670/1.56839a...
- hal: hal-04890347
- doi: 10.34692/9d3g-3z17
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.34692/9d3g-3z17
Mots-clés
alliage AMS datation radiocarboneSujets proches
C14 carbone 14 carbonne 14 datation C14 datation carbone 14CCiter ce document
Stéphanie Leroy et al., « La datation du fer par le radiocarbone : méthodologie et applications », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10.34692/9d3g-3z17
Métriques
Partage / Export
Résumé
La datation par le carbone 14 est certainement la méthode la plus répandue pour construire des chronologies sur les 40 000 dernières années. Alors que les restes organiques tels que le bois, le charbon, les végétaux ou les ossements demeurent les supports privilégiés des datations radiocarbone en archéologie, des matériaux complexes comme le fer peuvent constituer des solutions alternatives et/ou complémentaires pour produire des jalons chronologiques aux activités humaines. Les alliages ferreux anciens présentent néanmoins quelques écueils pour la datation radiocarbone comme une faible teneur en carbone (< 0,8 %), une grande hétérogénéité de structure et diverses possibilités de contaminations. Depuis 10 ans, le LMC14 et le LAPA développent une méthodologie spécifique basée sur une analyse approfondie du matériau ferreux (observations métallographiques et analyses élémentaires) qui permet un choix éclairé de la zone de prélèvement. Un protocole rigoureux d’échantillonnage et d’extraction du carbone permet ensuite d’éliminer les risques de contamination. Cette communication détaille les différents aspects de la méthodologie et s’appuie sur deux études d’objets en fer – les barres des épaves des Saintes-Maries-de-la-Mer et les renforts en fer de la Sainte-Chapelle à Paris – pour souligner l’importance d’une collaboration entre archéologues, archéométallurgistes et dateurs.