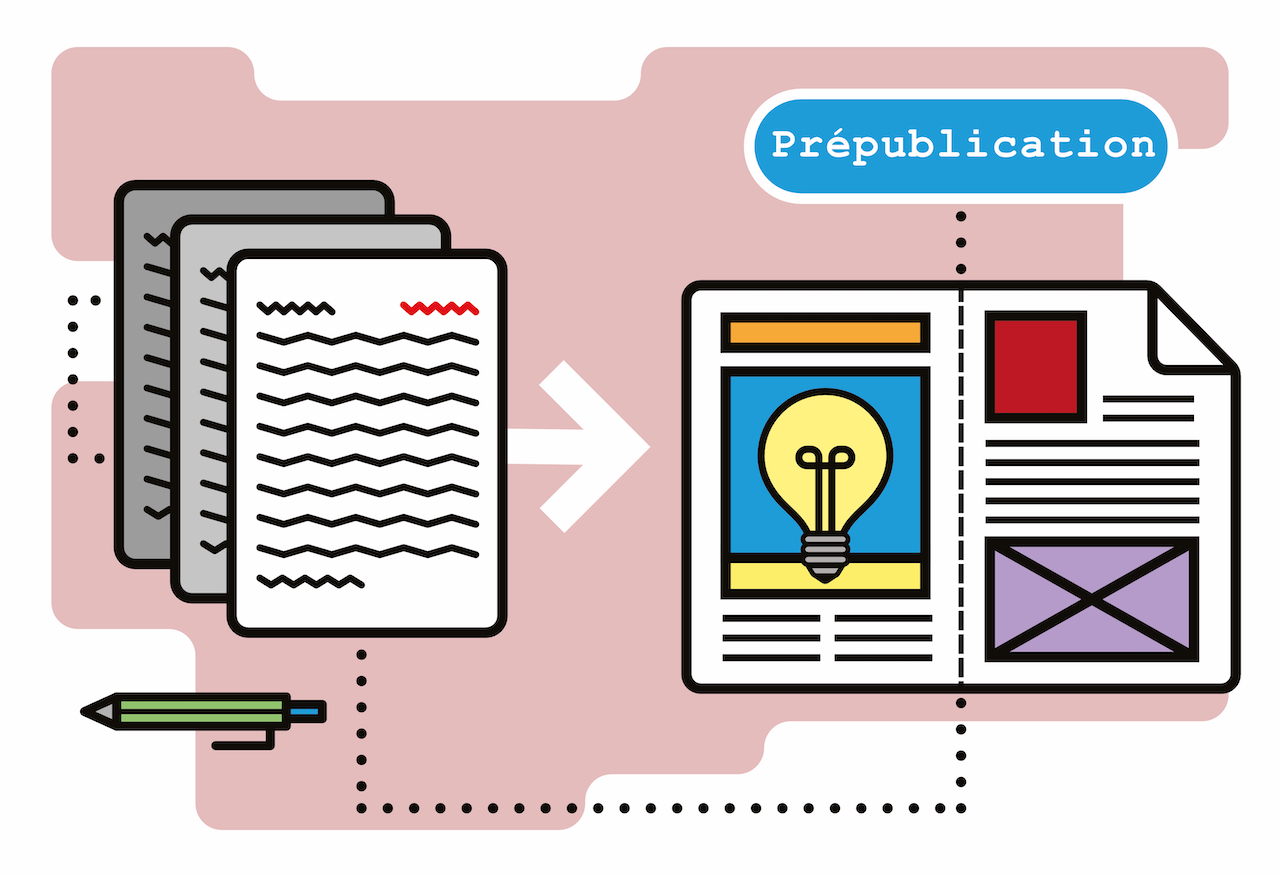Warum modellieren wir? Das Visuelle als Spiegelbild intellektueller Perspektiven in der mittelalterlichen Geschichte Why modeling? The visual as a reflection of intellectual perspectives in medieval history Pourquoi modéliser ? Le visuel comme reflet des perspectives intellectuelles en histoire médiévale
Fiche du document
2017
- ISIDORE Id: 10670/1.611950...
- hal: hal-04196189
- ARXIV: 2310.05949
HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société - notices sans texte intégral
Ce document est lié à :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2310.05949
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/ , info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Mots-clés
Graphic representations Medieval history Visualizations Data science Représentations graphiques Histoire médiévale Visualisations Techniques de visualisation Science des données -an]Sujets proches
Natural science Sciences Science of science Medieval history History, Medieval Middle Ages--History Medieval period World history, Medieval Dark Ages ArticleCiter ce document
Nicolas Perreaux, « Pourquoi modéliser ? Le visuel comme reflet des perspectives intellectuelles en histoire médiévale », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société - notices sans texte intégral, ID : 10670/1.611950...
Métriques
Partage / Export
Résumé
L’article interroge l’importance des représentations graphiques dans les sciences sociales et particulièrement en histoire (médiévale), en partant d’une réflexion d’Étienne-Jules Marey, un physiologiste, pionnier de la photographie et du cinéma du XIXe siècle. Ce dernier estimait que le visuel devait remplacer le langage dans de nombreux domaines. De fait, le XXe et le début du XXIe siècle ont vu une multiplication exponentielle des supports visuels, en particulier avec l’avènement du numérique. Cependant, cette « révolution graphique » n’a pas touché toutes les disciplines de manière égale. Des différences importantes subsistent en fonction des domaines scientifiques, comme l’astrophysique, l’anthropologie, la chimie et l’histoire médiévale, malgré leur engagement commun à décrire des processus dynamiques et des changements d’état. Or, si les historiens ont déjà numérisé une grande partie du patrimoine culturel de l’Antiquité jusqu’aux Xe-XIIIe siècles, l’exploration de ce corpus à l’aide de visualisations reste limitée. Il existe donc un potentiel inexploité dans ce domaine.L’article vise tout d’abord à esquisser une typologie et une quantification des rôles passés et potentiels des représentations visuelles en histoire médiévale. Il examine deux approches intellectuelles distinctes : 1. l’utilisation des visuels pour soutenir un discours scientifique (majoritaire) et 2. la construction d’un discours historique fondé sur des observations réalisées à partir de figures visuelles ayant pour objectif de modéliser des phénomènes invisibles à l’œil nu. L’auteur examine ainsi l’utilisation des « images » en médiévistique, en se concentrant sur les volumes annuels de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur (SHMESP), jusqu’en 2006. Deux autres parties du texte se penchent sur les formes encore rares de représentations visuelles en histoire médiévale, notamment celles à « vocation heuristique », utilisant des objets iconographiques, des parchemins, des édifices et des textes numérisés. L’article suggère diverses techniques de visualisation, telles que l’analyse de réseaux, la création de « stemmas 2.0 » et des chronologies interactives, qui pourraient être bénéfiques pour la discipline. Ces méthodes pourraient potentiellement faire évoluer en profondeur notre compréhension des sociétés anciennes, en montrant les relations dynamiques entre différents aspects de ces sociétés. L’une des avancées les plus importantes attendues de ces méthodes visuelles est une meilleure compréhension des modèles de l’essor de l’Europe médiévale, qui fut variable d’une région à l’autre. L’hypothèse soutenue est que la rareté des graphiques à vocation heuristique en histoire médiévale découle des rapports entretenus avec les documents anciens et de la méthode historique basée sur la narration et l’exemplarité. L’article interroge ainsi l’intérêt de la « modélisation visuelle » en histoire médiévale et souligne les défis liés à l’adoption généralisée de cette approche dans les sciences humaines et sociales. Enfin, le texte invite à réfléchir sur la nature et le fonctionnement des dispositifs visuels à vocation heuristique, en comparant les « images » médiévales et les visuels scientifiques contemporains. Dans les deux cas, il s’agit de matérialiser l’invisible pour montrer quelque chose qui existe au-delà du visuel. L’auteur suggère que cette manière d’aborder les visuels pourrait jouer un rôle croissant dans les décennies à venir, notamment dans le domaine des sciences des données.