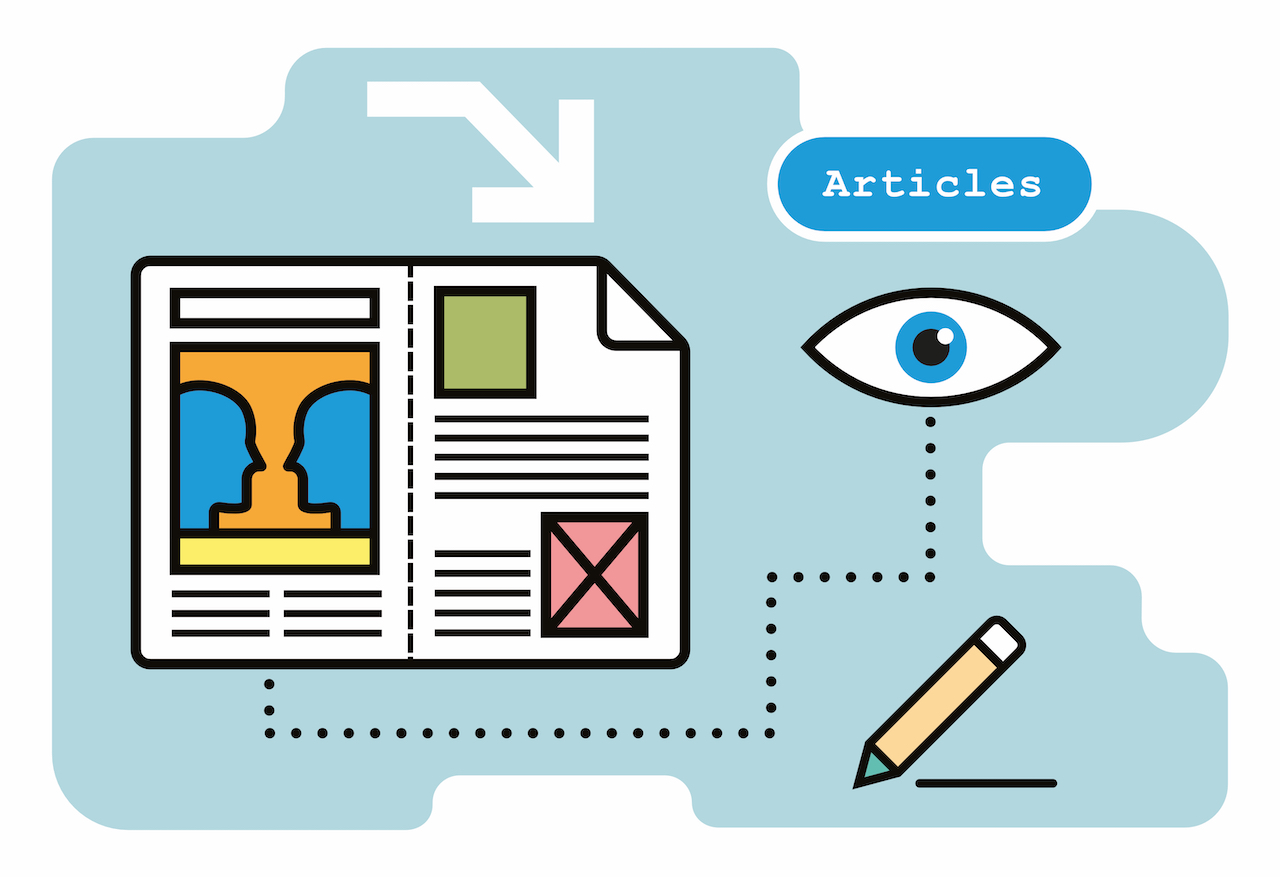Fiche du document
2007
- ISIDORE Id: 10670/1.86e5a2...
Cairn
Citer ce document
Vincent Caradec, « L'épreuve du grand âge », Retraite et société, ID : 10670/1.86e5a2...
Métriques
Partage / Export
Résumé
Cet article cherche à caractériser l’« épreuve du grand âge » sous la forme d’une tension entre « éloignement du monde » et «maintien dans le monde ». D’un côté, au fur et à mesure de l’avancée en âge, les « prises » de l’individu sur le monde tendent à s’effriter : il doit abandonner des activités ; certains de ses proches disparaissent ; le monde se transforme. De l’autre, il s’efforce de maintenir certaines de ces prises, voire d’en recréer, en s’engageant dans de nouvelles activités et de nouvelles relations et en cherchant à préserver des espaces de familiarité avec le monde. Cette perspective amène à étudier trois phénomènes. Tout d’abord la «déprise » : cette notion désigne le processus de réorganisation des activités qui se produit au cours de l’avancée en âge, au fur et à mesure que les personnes qui vieillissent doivent faire face à des contraintes nouvelles (une santé défaillante et des limitations fonctionnelles croissantes, une fatigue plus prégnante, une baisse de leurs « opportunités d’engagement », une conscience accrue de leur finitude) dont la probabilité d’apparition s’accroît au fil de l’âge. Ensuite, l’article se penche sur la question de savoir si l’individu âgé est définitivement « achevé », ses assises identitaires appartenant désormais exclusivement au passé, ou s’il demeure encore ouvert à de possibles transformations de soi. Enfin, il analyse le développement d’un sentiment d’étrangeté au monde, contrebalancé par le souci de préserver certains espaces de familiarité. Loin d’être homogène, l’épreuve du grand âge se décline différemment suivant les ressources dont disposent les personnes très âgées pour s’en protéger ou pour la surmonter. Ces ressources ne relèvent pas seulement de l’équipement « personnel » de l’individu (son état de santé, sa force de caractère, les capacités cognitives ou d’adaptation qu’il a acquises au cours de l’existence), mais, plus largement, de ses « entours sociaux » : les aides techniques et humaines qui lui permettent de poursuivre ses activités malgré ses problèmes fonctionnels ; la présence et le soutien de ses proches ; les sollicitations qui lui sont adressées.