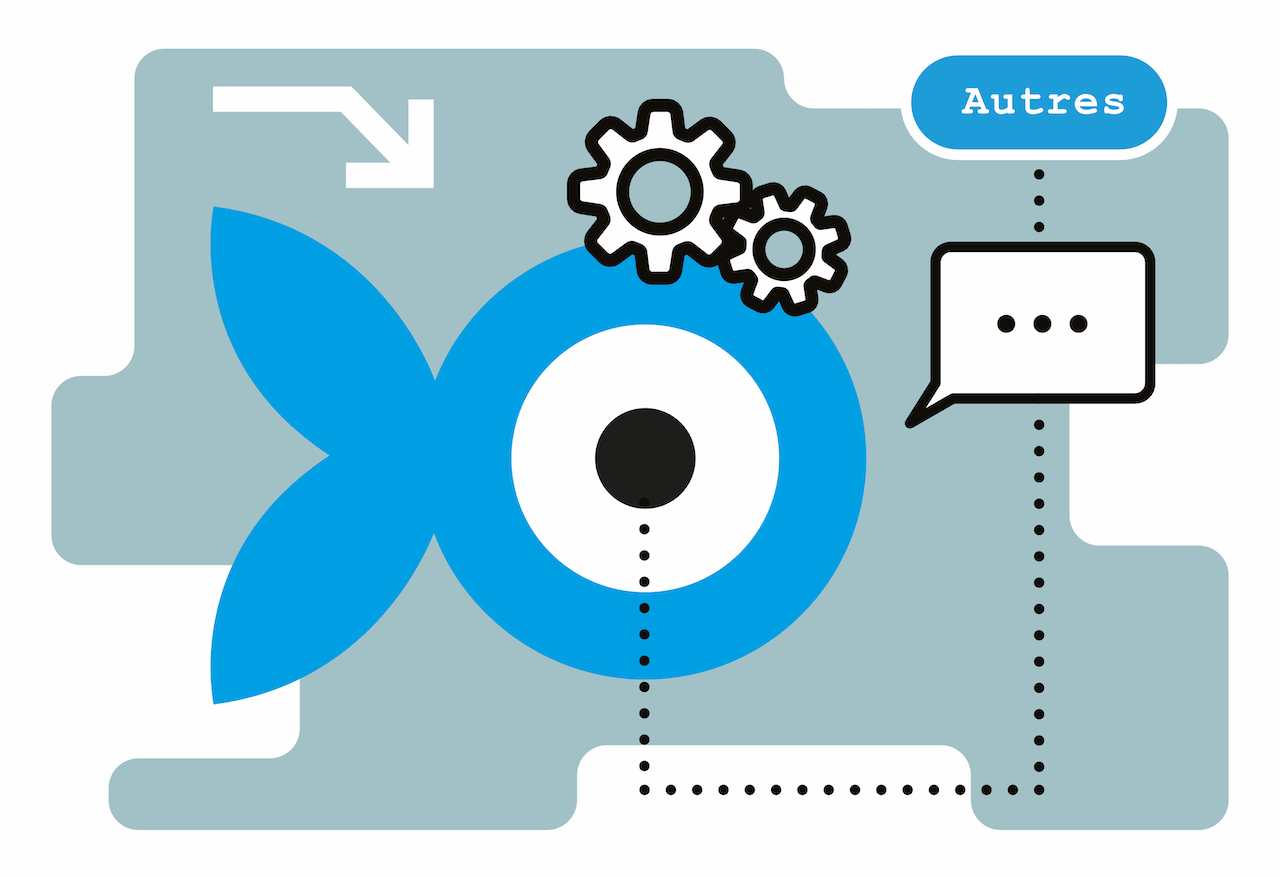Fiche du document
16 octobre 2020
- ISIDORE Id: 10670/1.b11c99...
- tel: tel-03049196
HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société - notices sans texte intégral
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ , info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Mots-clés
Palestine Palestine Moyen-Orient genre féminismes réfugiés images/cinéma documentaire frontières carcéral Moyen-Orient milieu carcéralSujets proches
Holy LandCiter ce document
Stephanie Latte Abdallah, « L’illégitime », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société - notices sans texte intégral, ID : 10670/1.b11c99...
Métriques
Partage / Export
Résumé
Ce dossier de HDR est composé de trois volumes. Le mémoire de synthèse, L’illégitime (Volume 1,124 p.) donne son titre à l’ensemble. Autour de la question de l’illégitime comme trame, comme approche, et des illégitimes - celles et ceux qui se trouvent hors-champ - comme sujets, ce texte propose une réflexion épistémologique sur un parcours et sur le point de vue à partir de grands thèmes de recherche : l’histoire anthropologique des réfugié·es palestiniens ; le genre, le corps et les affects ; les féminismes, séculiers et religieux, dans les sociétés arabes et musulmanes ; les images et les régimes de visibilité et d’invisibilité ; les frontières, l’enfermement et les mobilités dans les espaces israélo-palestiniens ; le carcéral en Israël/Palestine ; les enjeux de la narration en sciences sociales et de la post-disciplinarité autour du cinéma documentaire ; l’engagement et les citoyennetés alternatives en Palestine et au Moyen-Orient. Il pose les contours d’une épistémologie de l’illégitime construite à partir d’un positionnement féministe radical et d’une épistémologie cinématographique. Le manuscrit original La toile carcérale. Une histoire de l’enfermement en Palestine compose le Volume 2 (504 p, en cours de publication), et une sélection d’articles et travaux le Volume 3 (624 p.).Dans les Territoires palestiniens, depuis l’occupation de 1967, le passage par les prisons israéliennes a marqué les histoires personnelles et collective. Les arrestations et les incarcérations massives pour des motifs d’ordre politique ont au fil du temps installé une toile carcérale. Une toile carcérale qui est tout autant réalité que virtualité : une possibilité d’emprisonner, une suspension sans contours, à la fois visible et toujours hors-champ, une incertitude. Les pratiques pénales appliquées aux Palestiniens résidents des Territoires occupés sont des dispositifs de contrôle déterminants qui contribuent à un système frontalier (bordering system) qui s’ancre sur un régime de mobilité spécifique. Elles participent de la gestion des frontières de la nation : des frontières non-linéaires, qui se sont multipliées, sont en partie dématérialisées, mobiles et réticulaires (networked) et, dans le même temps, individualisées et sans fin. Nœud et noyau du rhizome de contrôle, la prison n’est pas un isolat. En raison de la porosité entre l’intérieur et l’extérieur des facilités carcérales, entre Dedans et Dehors, elle est un lieu clef pour analyser les processus politiques et les mobilisations en Palestine, à partir des citoyennetés carcérales qui s’y élaborent. Les effets de cette imbrication entre Dedans et Dehors s’étendent non seulement à la communauté des prisonnières, des prisonniers et des anciens détenu·es mais aussi aux milieux partisans et militants, à la société, aux communautés palestiniennes de Cisjordanie, de Jérusalem, de Gaza et d’Israël, aux habitants du Golan occupé. Avec le temps, cette porosité a fondu le Dedans et le Dehors dans un ethos carcéral partagé. La toile a capté l’espace territorial, relationnel, les corps et les têtes. Ce texte se situe dans l’entre-deux entre Dedans et Dehors, à la frontière entre ces espaces. Il analyse les relations, les interconnexions entre le Dedans et le Dehors, les subjectivités carcérales de 1967 à aujourd’hui, à travers les générations carcérales qui se sont succédé. L’omniprésence de la prison a fortement agi sur les subjectivités dans les Territoires. Mode de socialisation, la prison est aussi incorporée. Elle a eu des effets profonds sur les relations de genre, les masculinités, les féminités, et sur les vécus personnels. Elle est, pour certains, un lieu sans fin dont l’emprise perdure post-mortem.