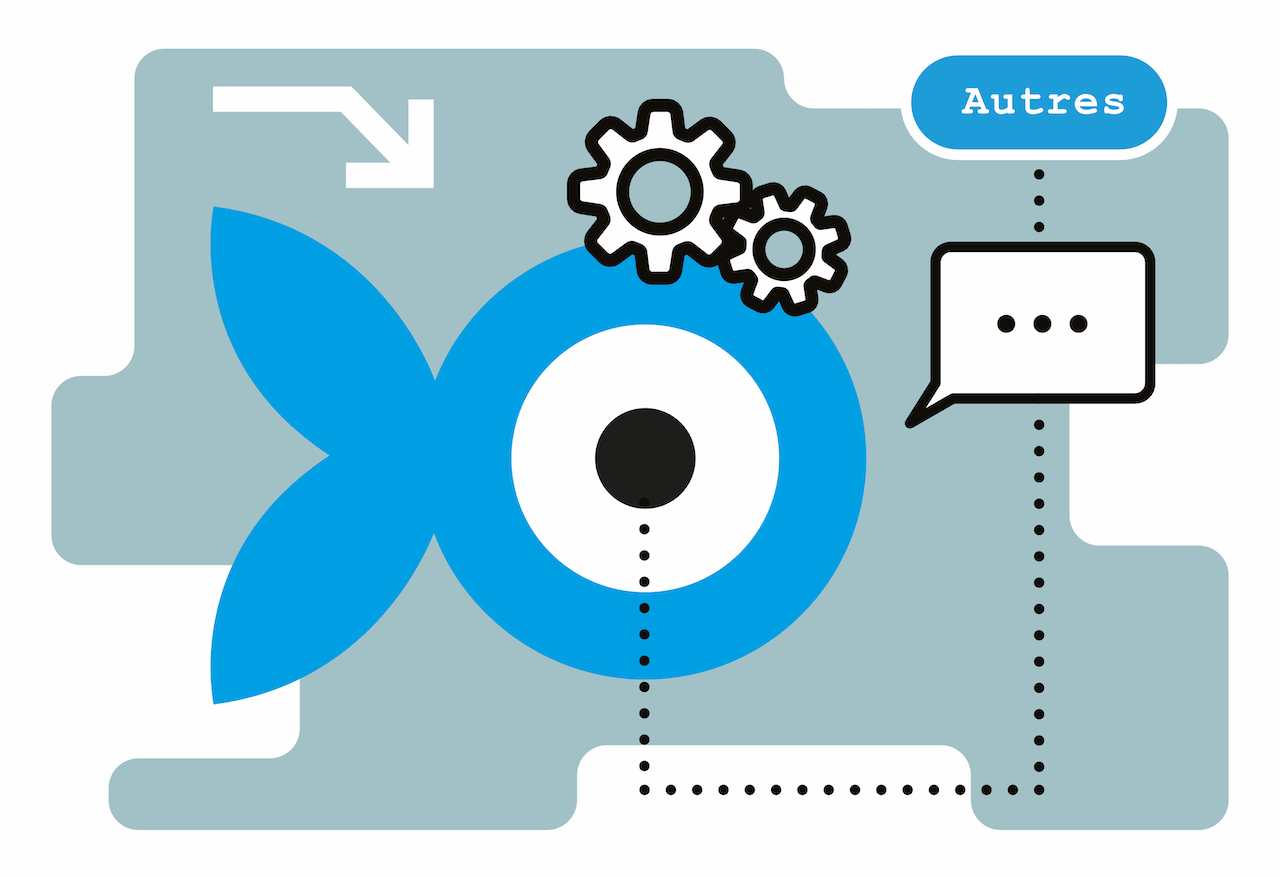Fiche du document
20 janvier 2025
- ISIDORE Id: 10670/1.dc385b...
- hal: hal-04957444
Mots-clés
Biopolique Addiction Drogue PharmakonCiter ce document
Alhy Leleu, « Drogues et addiction à l’ère néolibérale : une impossible santé ? », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.dc385b...
Métriques
Partage / Export
Résumé
Depuis plusieurs années, la question de la dépénalisation du cannabis côtoie dans les pages des journaux l’épidémie d’overdoses à l’Oxycotin aux Etats-Unis, les affaires de corruption pour narcotrafic et la consommation toujours plus importante d’antidépresseurs et d’anxiolytiques à travers le monde. La médiatisation de ces phénomènes présentés tour à tour comme des enjeux de santé publique, des problèmes de sécurité, des questions économiques et des dilemmes moraux nous rappellent la place centrale des substances psychoactives dans le fonctionnement des sociétés à travers l’histoire. Toutefois, les changements de plus en plus rapides des législations encadrant le commerce de ces produits ainsi que la puissance sans précédent de l’industrie pharmaceutique invitent aussi à poser à nouveau frais la question de la frontière entre drogues légales, drogues illégales et médicaments. Quels sont les intérêts qui motivent la libéralisation, la production, l’interdiction ou la criminalisation de certaines substances ? Quelle est la rationalité qui gouverne la régulation des drogues ? Derrière ces questions apparaît en filigrane le problème de la distinction de moins en moins nette entre dépendance psychologique et consommation quotidienne, autrement dit celle entre le normal et le pathologique. Si ce n’est pas le besoin de consommer tous les jours une même substance qui définit l’addiction alors comment expliquer l’inquiétude grandissante à l’égard de ce phénomène, ce dont témoigne notamment l’essor de l’addictologie comme champ de recherche autonome ? Une hypothèse serait de suivre les neurosciences qui invitent à voir la pathologie addictive comme un dysfonctionnement cérébral signe d’une perte de liberté et résultat d’une recherche inconsidérée de plaisirs immédiats. Dès lors, celle-ci peut être en partie décorrélée de la question des drogues et élargir son champ d’application à l’ensemble des activités de l’existence. L’encadrement discursif et juridique de l’usage des drogues et des conduites addictives peut alors être lu comme une forme de gouvernementalité par le toxique, entre biopolitique et nécropolitique, où l’administration des substances répond à des objectifs de classification des individus entre vies bonnes et des corps abjects.