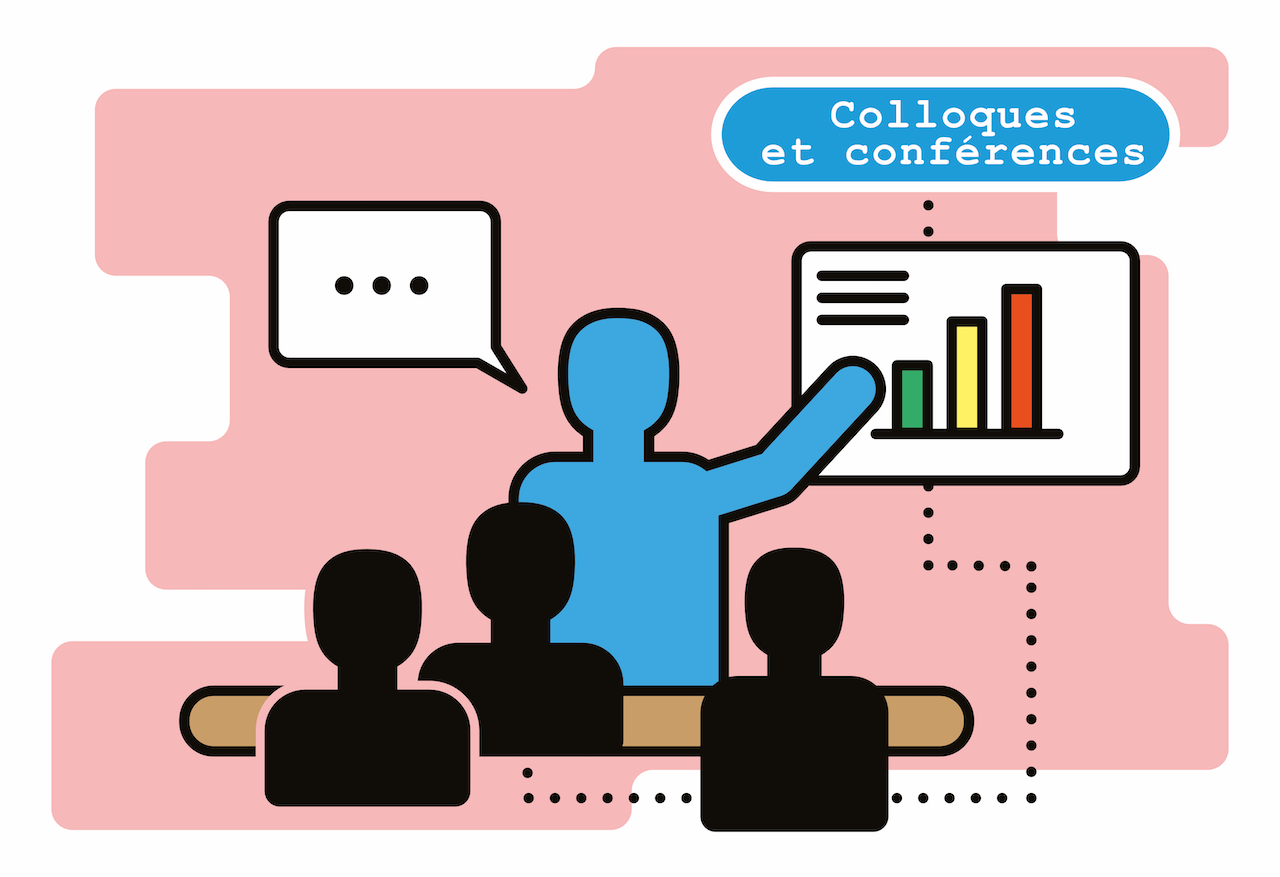Stonemasons, and even engineers, for megalithic building in Neolithic Europe? Des maçons, voire quelques ingénieurs, pour le bâti mégalithique du Néolithique européen ?
Fiche du document
4 juin 2018
- ISIDORE Id: 10670/1.dedf30...
- hal: hal-02092917
HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société - notices sans texte intégral
Mots-clés
Megaliths Social organization Architecture Europe Néolithique Mégalithes Europe Sociétés ArchitectureSujets proches
Architectural engineering Construction Buildings--Design and construction Engineering, Architectural Appareillage Génie architecturalCiter ce document
Luc Laporte et al., « Des maçons, voire quelques ingénieurs, pour le bâti mégalithique du Néolithique européen ? », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société - notices sans texte intégral, ID : 10670/1.dedf30...
Métriques
Partage / Export
Résumé
Les méthodes d'étude du bâti mégalithique ont été largement renouvelées au cours des dix dernières années. On peut désormais suivre la progression du chantier de construction, avec parfois des résultats surprenants comme ceux acquis à l'occasion de la fouille des parties orientales du tumulus C de Péré à Prissé-la-Charrière. Rampes, plans inclinés et terrasses étagées servent de soubassement à la construction. Le plan des élévations est d'abord dessiné au sol, parfois à chaque étape de la construction. Celle-ci connaît aussi quelques repentirs, ou des arrêts du chantier. Une première partie de la communication illustrera les méthodes mises en œuvre pour arriver à de telles conclusions. La seconde partie traitera de l'organisation du travail sur le chantier, d'abord au travers de différences savoir-faire inégalement réparties dans l'espace. Localement, elles pourraient rendre compte d'une coordination, par des acteurs spécialisés, d'équipe au travail plutôt segmenté, en revanche. Plus largement, et au travers d'exemples pris également dans d'autres régions (Bretagne, Iles Britanniques ou Péninsule Ibérique), on discutera également du rôle de tels chantiers dans la transmission des connaissances ou de l'existence de spécialistes itinérants; des maçons puisqu'alors ce serait ainsi qu'il faut les appeler. Quant à la conception du projet architectural, comme pour la mise en œuvre du projet d'ensemble, se pose également la question de l'existence de quelques intervenants faisant office d'ingénieurs, même si ce terme peut paraître anachronique par rapport à ce que l'on sait - ou croit savoir - de l'organisation sociale des groupes humain du Néolithique en Europe occidentale. Autant de perspectives nouvelles tendant à dégager définitivement l'étude de ces mégalithes d'un présupposé de "primitivisme", tenace, qui plonge profondément ses racines dans l'histoire des recherches sur ce sujet.