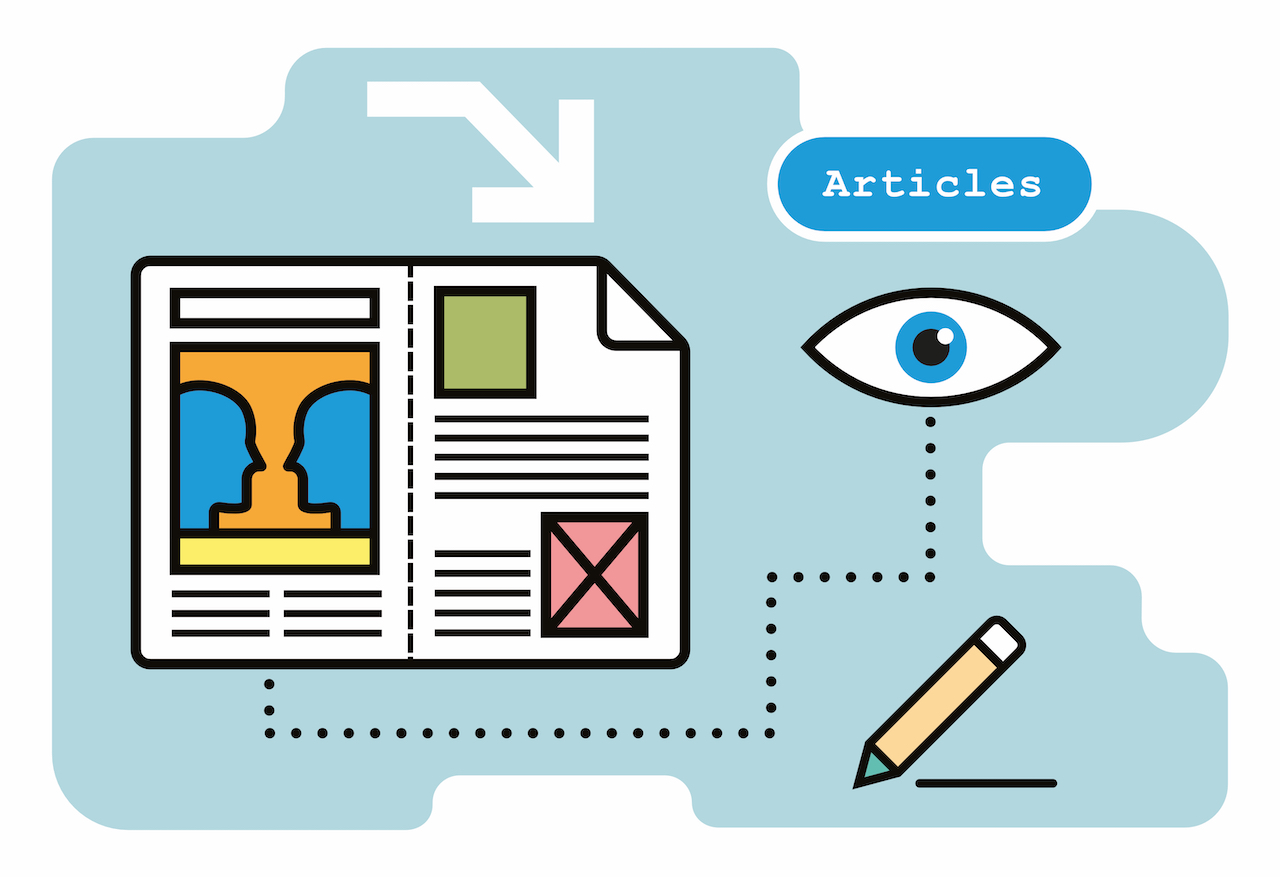Fiche du document
2021
- ISIDORE Id: 10670/1.e6e444...
Cairn
Sujets proches
Feature films--History and criticism Movies Films Moving-pictures Cinema Feature films--History and criticism Movies Films Moving-pictures Cinema Photography--Animated pictures Photography--Motion pictures Fotografía cinematográfica Técnica cinematográfica Septième art Films Oeuvres cinématographiques Films de cinéma Films (oeuvres cinématographiques) Art cinématographique 7e art CinématographieCiter ce document
Jérôme Bourdon, « Le cinéma israélien, entre courage et alibi ? », Confluences Méditerranée, ID : 10670/1.e6e444...
Métriques
Partage / Export
Résumé
Depuis les années 2000, Israël exporte avec succès un nouveau cinéma, donnant place au destin de groupes jusque-là peu ou pas représentés sur l’écran : femmes, juifs mizrahim (orientaux), minorité palestinienne d’Israël. Ce cinéma plus critique n’est-il pas aussi utilisé comme « soft diplomacy » par un État particulièrement soucieux de son image ? Fondée principalement sur une analyse des critiques de films en France, États-Unis, Grande-Bretagne et Israël, cet article propose une réponse nuancée. La pratique du financement et la production de ces films n’obéit pas à un souci politique. Bien reçus à l’étranger, et très minoritaires, les films critiques de l’armée et de l’occupation suscitent l’ire des représentants de l’État israélien, qui, sous Netanyahou, sont allés jusqu’à l’appel à l’autocensure. Au-delà de toute intention politique, les films font l’objet de réinterprétations et de malentendus qui peuvent provoquer des effets imprévisibles, par exemple sur la compréhension du statut des femmes, juives ou arabes, en Israël. Chaque pays met l’accent sur des aspects différents : l’Angleterre est la plus critique et la plus politique, les critiques français écrivent dans le contexte de leur culture cinéphilique, les Américains sont les plus prudents à l’instar de leurs journalistes. À l’exception de certains cinéastes palestiniens d’Israël, les créateurs ne s’exilent pas ou très peu, et continuent de porter un discours critique, par ailleurs rare dans les médias israéliens.