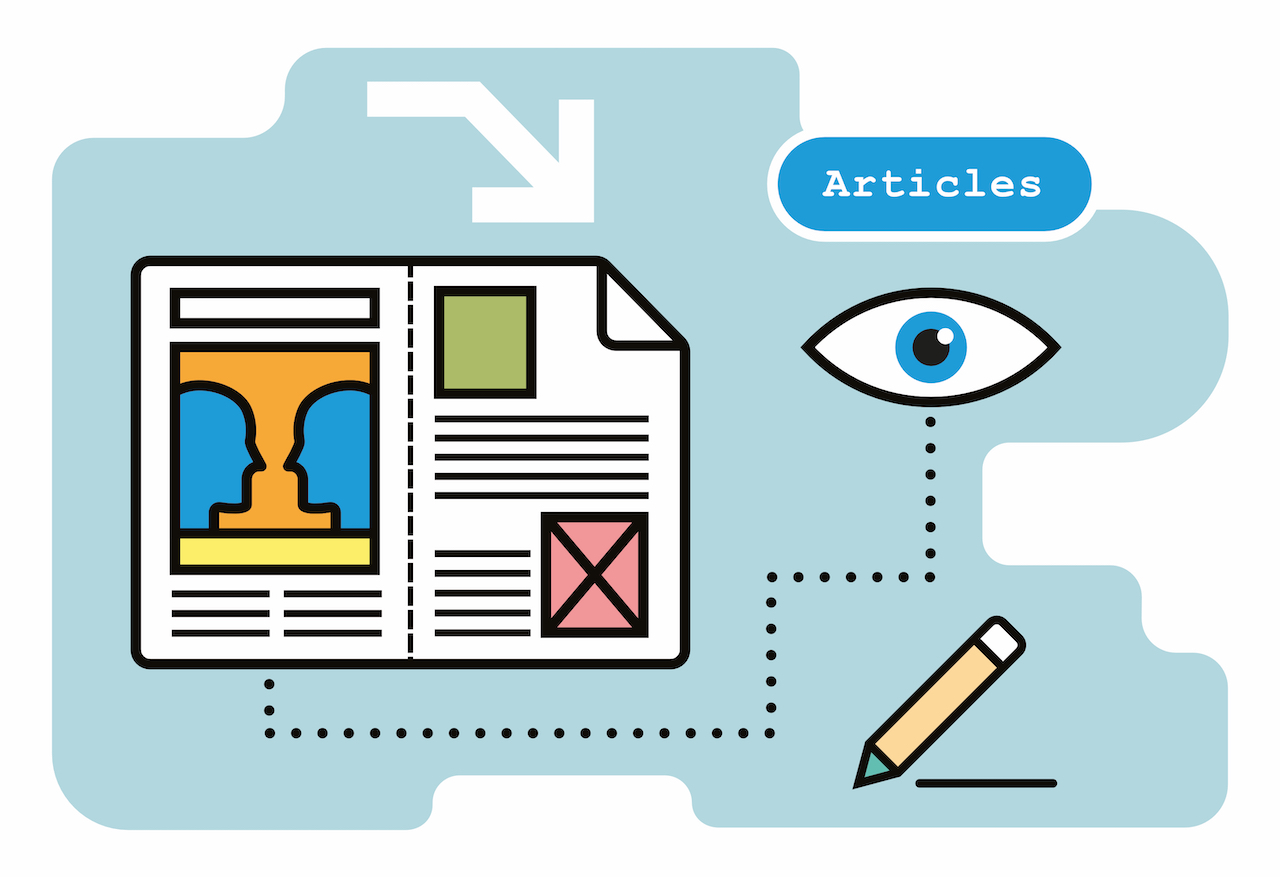Reconciling traditional Prehistory and mathematical modelling to examine human–environment relations during the Upper Palaeolithic: concepts and methods for modelling eco-cultural niches (Ré)concilier Préhistoire traditionnelle et modélisations mathématiques pour examiner les relations humainsenvironnements au Paléolithique supérieur : concepts et méthodes pour la modélisation de niches éco-culturelles
Fiche du document
31 mars 2025
- ISIDORE Id: 10670/1.f146f4...
- hal: hal-05023274
http://hal.archives-ouvertes.fr/licences/etalab/ , info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Mots-clés
eco-cultural niche modelling prehistory Gravettian Rayssian culture/environment relationships rapid climate change eco-cultural niche modelling prehistory Gravettian Rayssian culture/environment relationships rapid climate change modélisation de niches éco-culturelles Préhistoire Gravettien Rayssien relations culture/environnements changements climatiques rapidesSujets proches
Gravettien culture Pavlovien culture Gravetien Culture gravettienne Civilisation gravettienne Périgordien supérieurCiter ce document
Anaïs Vignoles, « (Ré)concilier Préhistoire traditionnelle et modélisations mathématiques pour examiner les relations humainsenvironnements au Paléolithique supérieur : concepts et méthodes pour la modélisation de niches éco-culturelles », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.f146f4...
Métriques
Partage / Export
Résumé
Face au réchauffement global de la Terre, une préoccupation grandissante de nos sociétés concerne la façon dont ces dernières seront capables de surmonter les difficultés induites par les changements rapides de leurs environnements. Bien qu’ils ne soient jamais posés à une échelle si courte et globale, ces questionnements ne sont probablement pas nouveaux à l’échelle de l’histoire humaine. Notre espèce a en effet développé des stratégies comportementales uniques lui permettant d’élargir considérablement sa niche écologique intrinsèque : des adaptations culturelles. Toutefois, la diversité chrono-géographique de ces dernières ne semble pas s’expliquer uniquement par des facteurs environnementaux, qui seraient un forçage externe aux groupes humains ; la relation des humains au reste du monde est elle aussi profondément culturelle. Dans ce contexte, comment caractériser les relations entre traditions culturelles et environnements en mutation ? Peut-on mettre en évidence plusieurs échelles de co-évolution culture/environnement ?Pour explorer ces questions, je propose d’intégrer aux méthodes traditionnelles des préhistorien·nes la modélisation de niches éco-culturelles (abrév. MNEC), afin de constituer un cadre méthodologique mêlant intimement données culturelles et environnement. Cette approche permet d’identifier les environnements associés à la répartition géographique d’une tradition culturelle préhistorique (i.e. sa niche éco-culturelle). La comparaison de niches associées à différentes traditions permet ainsi de mettre en parallèle des dynamiques environnementales et des dynamiques culturelles de changement/stases. Dans cet article, je reprends les fondements théoriques de cette approche en Écologie et en Archéologie, tout en proposant des pistes de réflexion pour approfondir le cadre interprétatif de la MNEC.Dans un second temps, je propose de présenter une application de cette approche à une trajectoire technique du Paléo-lithique supérieur européen : l’apparition, généralisation et disparition du Rayssien au cours du Gravettien. Cette tradition technique lithique régionale et originale a souvent été interprétée comme une réponse culturelle des populations à un changement d’environnement, mais cette hypothèse n’a jamais fait l’objet d’un examen concret dans la littérature. J’ai donc appliqué l’approche de la MNEC à cette question, en comparant la niche éco-culturelle associée au Rayssien avec celle du Noaillien (qui le précède) et le Gravettien récent (qui lui succède). L’estimation de la répartition géographique de ces unités archéologique s’est fondée sur une revue critique de la littérature intégrant des études de collections, afin de garantir la qualité des jeux de données nourrissant les modèles de niches subséquents. Concernant les données climatiques, celles-ci proviennent de simulations publiées et vérifiées issues du modèle HadCM3 pour les périodes correspondant aux transitions entre Noaillien et Rayssien, puis entre Rayssien et Gravettien récent selon le dernier modèle chronologique en date (Banks et al., 2024). Ces données ont servi à créer des modèles de niches d’ellipsoïdes dans l’espace environnemental, permettant de caractériser des dynamiques écologiques associées aux dynamiques culturelles observées. Les comparaisons de volumes ont été soumises à un test statistique de randomisation afin de vérifier leur signification. Les résultats de cette analyse mettent en évidence le rôle de la variabilité climatique dans la trajectoire du Rayssien, per-mettant ainsi de proposer un modèle interprétatif cohérent intégrant des données culturelles et écologiques. D’une part, ils permettent de mettre en parallèle l’apparition et la généralisation du Rayssien avec une spécialisation écologique et une spécialisation de la chasse sur le renne. Sa disparition au début du Gravettien récent pendant le GI4 est accompagné d’un changement significatif de niche vers des conditions écologiques plus étendues, ce qui corrobore l’occupation de nouveaux territoires dans le nord de la France et l’Ouest de l’Allemagne. Ce nouveau modèle permet de préciser les mécanismes impliqués dans la trajectoire du Rayssien, ainsi que de mettre en lumière de nouvelles perspectives d’étude dans le registre archéologique.