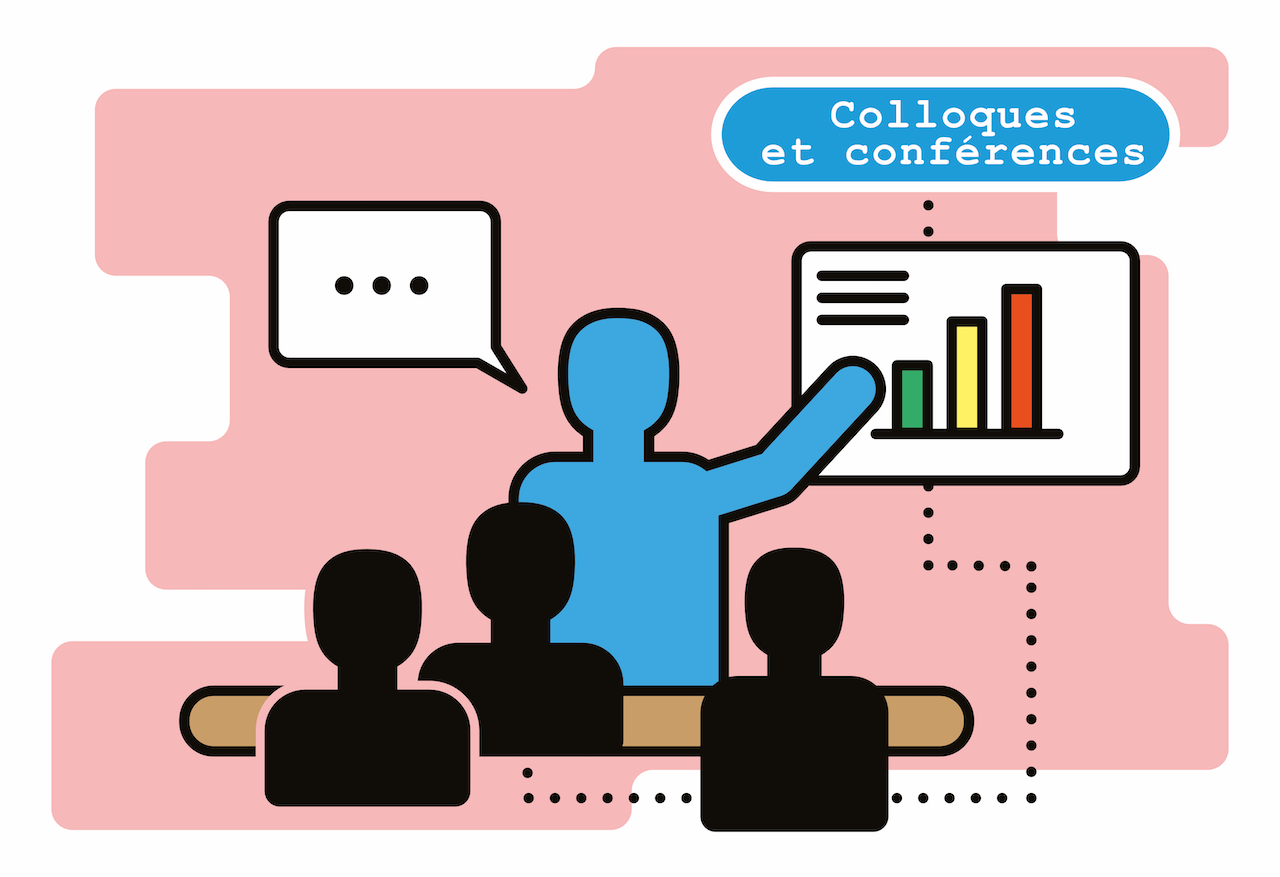Répartition des naissances, saisons d’agnelage et consommation de viande d’agneaux en Provence médiévale : regards croisés de l’archéozoologie, de l’Histoire et de l’analyse isotopique
Fiche du document
5 juin 2023
- ISIDORE Id: 10670/1.06bded...
- hal: hal-04254783
Mots-clés
Seasonality Animal breeding LambingSujets proches
Frontier troubles Meats Archaeozoology Zoology in archaeology Zooarchaeology Teoría del consumo Archéo-zoologie Animaux en archéologie Vestiges d'animaux (archéologie) Ostéoarchéologie animale Ossements d'animaux (archéologie) Restes d'animaux (archéologie) Vestiges osseux (archéologie) Zoologie et archéologie Ostéométrie Zooarchéologie Archéologie et zoologie Restes osseux (archéologie) Analyse historique Sciences historiques Science historique Consommation (théorie économique) Consommation (économie politique) Dépenses de consommation Produits carnésCiter ce document
Sylvain Burri et al., « Répartition des naissances, saisons d’agnelage et consommation de viande d’agneaux en Provence médiévale : regards croisés de l’archéozoologie, de l’Histoire et de l’analyse isotopique », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.06bded...
Métriques
Partage / Export
Résumé
L’importance des caprinés domestiques dans la Provence médiévale (Xe-XVe siècles) n’est plus à démontrer. Les recherches tant historiques qu’archéozoologiques les placent comme la principale source de viande dans les villes et villages de la région. Cependant, les dernières recherches menées en Provence centrale soulèvent des questions sur la rythmicité de l’élevage et sur la gestion des troupeaux à l’époque médiévale. En effet, ces études se sont heurtées à deux visions contradictoires fournies, d’une part, par l’archéozoologie et le cycle naturel de reproduction, et d’autre part, par les sources historiques et le contexte religieux. La célébration de Pâques est caractérisée dès les débuts du christianisme (IIe siècle après J.-C.) par la consommation de viande d’agneau (et de chevreau). Les récits des bouchers provençaux du XIVe siècle indiquent une consommation massive d’agneaux de lait (trois à six semaines) au printemps. Cependant, l’archéozoologie révèle la forte consommation d’agneaux plus âgés (trois à six mois) au sein de plusieurs contextes élitaires dans le Nord de la France, en Angleterre mais aussi en Provence. Si leur naissance suit un cycle naturel (fin d’hiver ou printemps), ces individus, bien que nombreux, ne correspondent ni aux habitudes religieuses ni aux sources textuelles disponibles. Cette observation nous amène à envisager un agnelage « hors saison » et notamment un agnelage automnal. Si ce « désaisonnement » est caractéristique des élevages ovins actuels du pourtour méditerranéen et se manifeste dès le Néolithique ancien, son histoire reste à explorer. Cette communication vise donc à appréhender les liens entre l’élevage et les contextes culturels/religieux et à enrichir l’histoire des pratiques zootechniques en Méditerranée occidentale. La croisée de l’archéozoologie, de l’Histoire et de l’analyse isotopique nous permettra de discuter (a) de la rythmicité de la disponibilité des produits carnés au cours de l’année (b) de l’adaptation des pratiques d’élevage et/ou commerciales pour fournir aux populations privilégiées des produits de qualité.