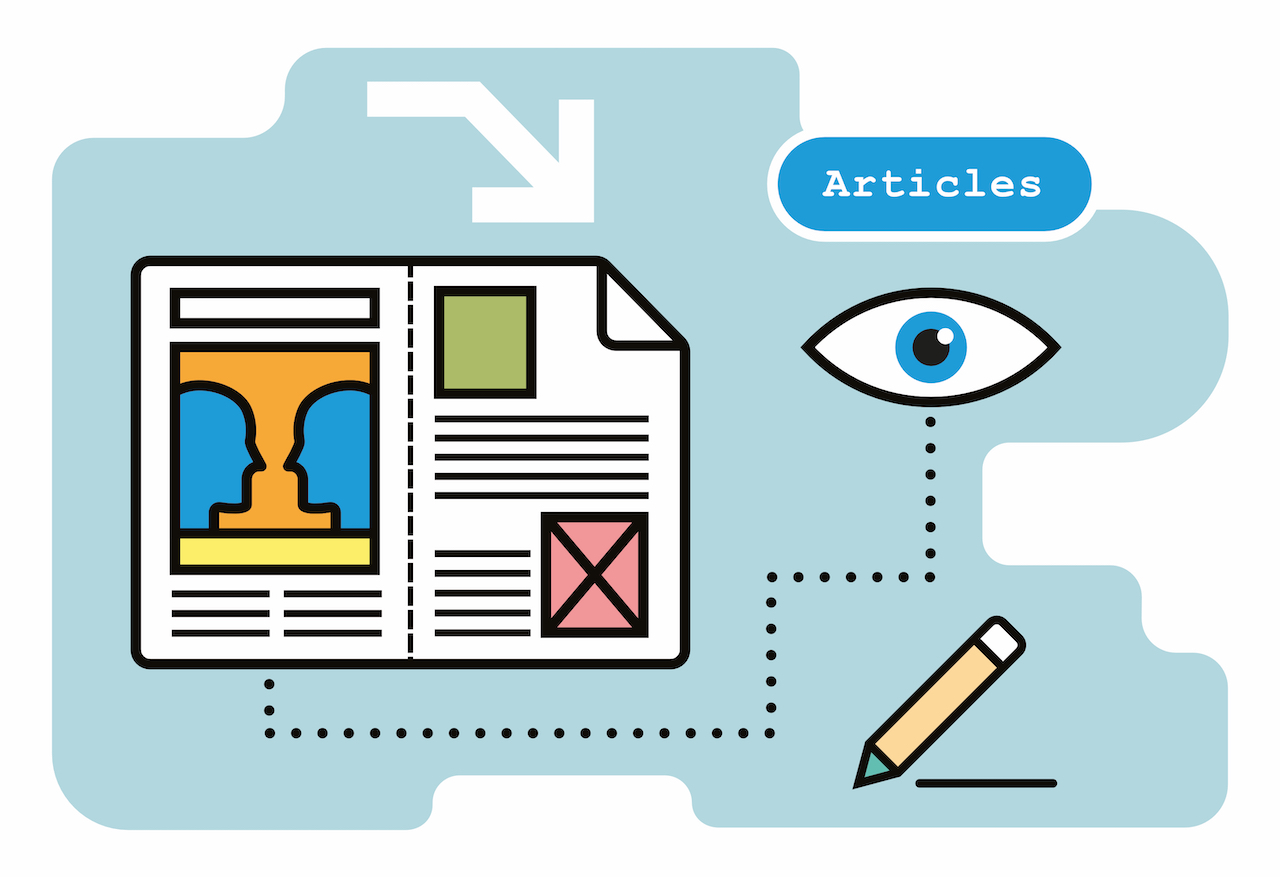Fiche du document
2016
- ISIDORE Id: 10670/1.cef830...
- halshs: halshs-01614131
Mots-clés
Clitic pronouns Agreement West Iranian languages Pronoms clitiques accord langues iraniennesSujets proches
Gramática comparada y general--Clíticos Enclise Atones (linguistique) Cliticisation Enclitiques Proclitiques ProcliseCiter ce document
Thomas Jügel et al., « Les pronoms enclitiques dans les langues ouest-iraniennes. Fonctions et distribution géographique », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.cef830...
Métriques
Partage / Export
Résumé
Alors que les pronoms clitiques constituaient un trait commun des langues moyens iraniens, ils ont connu des destins divers dans les langues iraniennes modernes de l’ouest, en ce qui concerne leur maintien (ou non), leurs fonctions et leur placement. Totalement disparus de certaines d’entre elles, ex. le zazaki ou le kurmandji, ils ont survécu dans d’autres, tout en maintenant leur fonction pronominale initiale, ex. le persan, ou en y ajoutant la nouvelle fonction de marqueur d’accord sujet-verbe, ex. le sorani, voire en perdant leur ancienne fonction au profit de cette dernière, ex. le talysh. En ce qui concerne leur placement, ils ont abandonné leur position de Wackernagel pour se rapprocher du verbe : leur placement ne se détermine plus par rapport au premier mot accentué de la phrase mais par rapport au domaine verbal, ex. le sorani, voire au verbe, ex. le persan.Cet article est consacré aux deux premières questions, c’est-à-dire le maintien (ou non) et les fonctions des « pronoms » clitiques dans les langues iraniennes de l’ouest. Nous dresserons tout d’abord un état des lieux de fonctions de ces clitiques dans les langues où ils ont survécu, au regard des fonctions qu’ils assumaient en moyen iranien. Nous nous intéresserons ensuite à la question de l’existence d’une corrélation possible entre le maintien du marquage casuel pour les noms d’une part et la perte des pronoms clitiques d’autre part. Cette corrélation, plausible au premier abord si l’on compare le sorani (sans cas mais disposant de pronoms clitiques) au kurmandji (avec cas mais pas de pronoms clitiques), s’avère toutefois non systématique à l’issue d’un examen détaillé d’un grand nombre de langues et de dialectes. Toutefois, la projection cartographique de ces deux paramètres (l’existence ou non d’un marquage casuel et l’existence ou non des clitiques), combinés à un troisième paramètre indiquant la fonction des clitiques (pronom vs marque d’accord), permet de mettre en évidence une distribution géographique intéressante en fonction du type de langues. Deux pôles géographiques se distinguent : le sud, où le cas est abandonné, et le nord, où les pronoms clitiques sont abandonnés. La transition entre les deux pôles se fait par une zone intermédiaire, où les « pronoms » clitiques, tout en étant maintenus, ont cessé de fonctionner comme des pronoms pour se consacrer à la réalisation de l’accord sujet-verbe.